
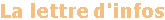 |
A voir et à lire
sur
19e.org,
et ailleurs.
 |
|
 | |


sur 19e.org |
|
|
|
|


La
" propagande par le fait " :
les attentats anarchistes (1892-1894).
L'assassinat
du Président Sadi Carnot,
24 juin 1894.
par Marc Nadaux
|
 |
Le 24 juin
1894, le Président de la République est à Lyon où il est venu visité
l'Exposition universelle. Sadi Carnot se rend dans un
landau découvert au Grand-Théâtre applaudir une représentation
d'Andromaque. Il est alors blessé d'un coup de poignard donné par un jeune
homme qui vient de fendre le public. C'est la consternation générale.
Atteint à l'aorte, le chef de l'État décédera quelques heures plus
tard, le 25 juin à 0 h 30.
Son meurtrier est un anarchiste italien, Santo Jeronimo Caserio, âgé de
vingt ans et venu de Sète où il était apprenti boulanger. Jugé les 2
et 3 août 1894, le jeune homme affirme avoir agi seul. De nombreux
éléments viennent cependant étayer la thèse du complot. Il est exécuté
quelques temps plus tard.
Du 26 juin au 1er juillet, une foule imposante vient se
recueillir sur la dépouille de Sadi Carnot, dans une chapelle ardente
installée au palais de l'Élysée. L'opinion est choquée. Cet attentat
marque d'ailleurs la fin de l'emploi de la terreur par les révolutionnaires
anarchistes. La " propagande par le fait " qui n'est pas parvenue
à déstabiliser la société aboutit à une impasse. |
 |
D'après
Le Petit Journal, 2 juillet 1894. |
 |
D'après Le Figaro, 25 juin 1894. |
L'assassinat du Président Sadi Carnot
par l'anarchiste italien Caserio,
le 24 juin 1894.

Le Petit Journal, 23 décembre 1893.
Voici le récit de
notre collaborateur Chincholle qui, on le sait ; avait été délégué par Le
Figaro pour suivre le Président de la république dans ce voyage à Lyon,
voyage que personne ne pouvait prévoir aussi émouvant et terrible :
Je sortais de la Place Saint-Bonaventure pour me rendre à la Préfecture. A
ce moment même le Président sortait par la Place des Cordeliers qui s’étend
derrière la Bourse et où on attendait sa voiture.
Depuis plus d’une heure, une foule considérable est là. Tous les trottoirs
allant de la Bourse au Grand-Théâtre où doit se rendre le Président sont
également garnis de monde.
M. Carnot monte en voiture accompagné du docteur Gailleton et des généraux
Voisin et Borius. On l’acclame. La voiture l’emporte vers le Théâtre ; elle
parcourt à peine une centaine de mètres quand devant le Grand-Hôtel où je
suis descendu, un individu, vêtu de gris et âgé de vingt-cinq ans à peu,
s’élance le poignard à la main, sur M. Carnot , et le frappe en pleine
poitrine.
Il avait visé le cœur ; mais la lame a dévié, elle est entrée entre le foie
et l’intestin. Le coup néanmoins a frappé si terriblement M. Carnot qu’il
s’est affaissé inanimé au fond de sa voiture.
Immédiatement, le docteur Gailleton lui donne les premiers soins.
Les voitures, au lieu d’aller vers le Grand-Théâtre, sont dirigées vers la
Préfecture.
La foule s’élance sur l’assassin. Un employé du télégraphe, Monsieur
Guilhermier, lui casse son parapluie sur la tête. Les agents s’emparent de
l’assassin et le conduisent au poste voisin de la Préfecture où ils le
déshabillent complètement.
On l’interroge. C’est un Italien du nom Caserio, âgé de vingt-quatre ans. Si
les agents l’ont laissé approché de la voiture de M. Carnot, c’est qu’il
avait à la main une rose. Ils croyaient qu’il voulait la lui offrir.
M. Carnot est transporté dans ses appartements dont naturellement l’accès
est interdit. La consternation se répand dans la ville. Les témoins
regrettent qu’on les ai empêché de tuer Caserio.
Les pires nouvelles circulent. Il y a une seconde on prétendait que M.
Carnot était mort. Il n’en est rien. Mais la blessure n’en est pas moins
grave. Le foie serait perforé.
Une foule considérable, dont l’anxiété se conçoit, entoure la Préfecture.
Les docteurs Ollier et Poncet, interrogés par mille bouches, disent qu’il
n’y a point de danger, mais l’attitude du Préfet, M. Rivaud, absolument
consterné, est telle que l’inquiétude s’accroît.
Au poste, l’assassin, qui parle très mal le français, est interrogé en
italien. Il est très calme.
" Je m’expliquerai plus tard ", dit-il.
On a trouvé sur lui, outre le poignard, un couteau et un casse-tête.
Il est dix heures trente cinq. Pendant que j’écris en toute hâte, trois amis
vont aux nouvelles. Ils ont le plus grand mal à circuler. Il y a peut être
cent mille personnes autour de la Préfecture, et devant le télégraphe même
et une foule considérable qui voudrait que la presse lui donnât des
nouvelles.
De minute en minute elles sont plus mauvaises. Il faut penser en effet que
c’est au sortir du repas que le Président a été frappé, et par conséquent
l’intestin chargé.
Voici les nouvelles que nous apporte un témoin oculaire, notre confrère
Formentin, qui, dans le tumulte qui a suivi l’attentat, a pu entrer dans la
Préfecture, où il a même aidé les docteurs Poncet et Gailleton a transporter
M. Carnot complètement évanoui.
Les docteurs ont étalé un matelas sur un pliant dans la chambre du Préfet,
et ont étendu dessus le blessé dont ils ont arraché les vêtements.
La poitrine était couverte de sang. La blessure a quatre centimètres de
large ; le coup a été porté de bas en haut.
On a commencé par placé de la glace sur la plaie. Le Président était
toujours évanoui. Le docteur Poncet a jugé nécessaire de " débrider le
foie ".
On s’est demandé si on ne devait pas préalablement anesthésier le blessé ;
on a jugé que cela ferait perdre un temps précieux. On a donc fait
immédiatement l’opération.
Sur une longueur de vingt centimètres environ : on a ouvert la poitrine, et
constat que la foie était perforé de part en part.
Pendant l’opération, M. Carnot s’est ranimé : " Oh ! mon Dieu, que je
souffre ! répétait-il. Cela n’en finira donc pas ! … Mon Dieu que je
souffre ! Est-ce fini ? "
Quand l’opération était terminée, on l’a transporté sur son lit, où on a
constaté qu’il était absolument glacé. Le docteur Poncet est resté auprès de
lui.
Le docteur Ollier, le général Borius, le docteur Gailleton, M. Dupuy, le
colonel Chamoin sont passés dans une chambre voisine où ils ont tenu un
conciliabule qui est resté secret, mais à la suite duquel il a a été décidé
que M. Dupuy irait à Paris pour parer à tout.
On craint de plus en plus une issue fatale. Les docteurs Poncet et Gailleton
sont en permanence auprès du lit du blessé. Les médecins redoutent une
seconde hémorragie qui pourrait amené la mort.
Les étudiants sont en train de siffler le Consul italien qui demeure à
quelques pas du télégraphe central, cinq rue de la Barre. Une foule
considérable se joint à eux. Les gendarmes apparaissent. On crie :vive
Carnot ! A bas Crispi !
L’assassin, dont le vrai nom est Caserio Santo, est de Turin. On a trouvé
sur lui plusieurs lettres datées de Paris, quinze juin. Ils persistent à ne
vouloir parler que plus tard. On croit qu’il vient de Paris. Cependant, on
parle aussi de Sète où il se trouvait, paraît-il, hier encore avec un groupe
d’anarchistes. Il avait sur lui des lettres l’accréditant auprès de
plusieurs maisons de banque.
Cet anarchiste persiste à ne vouloir répondre que devant le jury. On a
trouvé dans a poche un carnet sur la première page duquel sont écrits ces
mots : Caserio Giovanni, corso Duca di Genova, distintissima famiglia
(Jean Caserio, cour du Duc de Gènes, de la famille la plus distinguée).
S’il est de famille distinguée, il n’en a pas l’air, son attitude est, au
contraire, des plus vulgaires.
M. Elisi de Saint-Albert, conseiller de Préfecture, M. Rivaud et M. Mayer,
chefs de division, sont entrain d’interroger Caserio. Il ne veut pas dire
s’il est anarchiste. Il prétend être arrivé aujourd’hui à sic heures de
Sète. On voudrait le mener à la Permanence, mais il y a tellement de monde
autour du poste qu’on ose pas l’en faire sortir, la foule tuerai.
La foule s’est portée contre le café de M. Isaac Casati, dont elle a
absolument défoncée la devanture, bien que ce soit un café fort connu pour
sa clientèle essentiellement française et fort considéré des Lyonnais. On a
saccagé tout l’établissement, pendant que les clairons de la Société, des
Touristes lyonnais, sonnaient la charge.
La foule se dirige présentement vers le café Maderni, qui appartient à un
Italien.
Dans les rues de Lyon, circulent maintenant d’épais groupes qui, brandissent
des drapeaux tricolores, chantent la Marseillaise sous les fenêtres
des Italiens. Les journaux locaux tirent des éditions supplémentaires mais
la police arrête tous ceux qui les vendent.
C’est fini, Mme Carnot arrivera trop tard. A minuit quarante deux , le
Président a rendu le dernier soupir au milieu de la consternation des
personnes restées auprès de lui : ses deux médecins, le général Borius, le
colonel Chamoin, M. Rivaud, M. Gravier, l’archevêque de Lyon qui n’a pas
quitté la Préfecture depuis qu’on y a ramené le Président et qui, au moment
où les médecins ont pressenti la fin lui a administré les derniers
sacrements.
C’est en pleurant qu’on nous donne la funèbre nouvelle. Ce matin encore, M.
Carnot était si joyeux ! Il avait, il n y a pas quatre heures, un succès si
retentissant ! On a tant de fois crié aujourd’hui : " Vive Carnot ! " et
maintenant, la pensée de tous va à la malheureuse femme qui est entrant de
faire un si cruel voyage et qui arrivera trop tard.
Peu de personnes encore connaissent ici la vérité et celles qui la
connaissent sont anéanties, écrasées, et précisément parce que, de neuf
heures du matin à neuf heures du soir, elles ont pris part à l’enthousiasme
général, elles ne peuvent retenir leurs larmes.
Le Figaro, 25 juin 1894.
|



