Mémoires dictées à ses
gardiens dans la soirée du 30 mars 1892.
Le sus-nommé après avoir mangé de
bon appétit nous a parlé en ces termes :
Messieurs, j'ai l'habitude, partout où je me trouve de faire de la
propagande. Savez-vous ce que c'est que l'Anarchie?
A cette demande nous avons répondu que non.
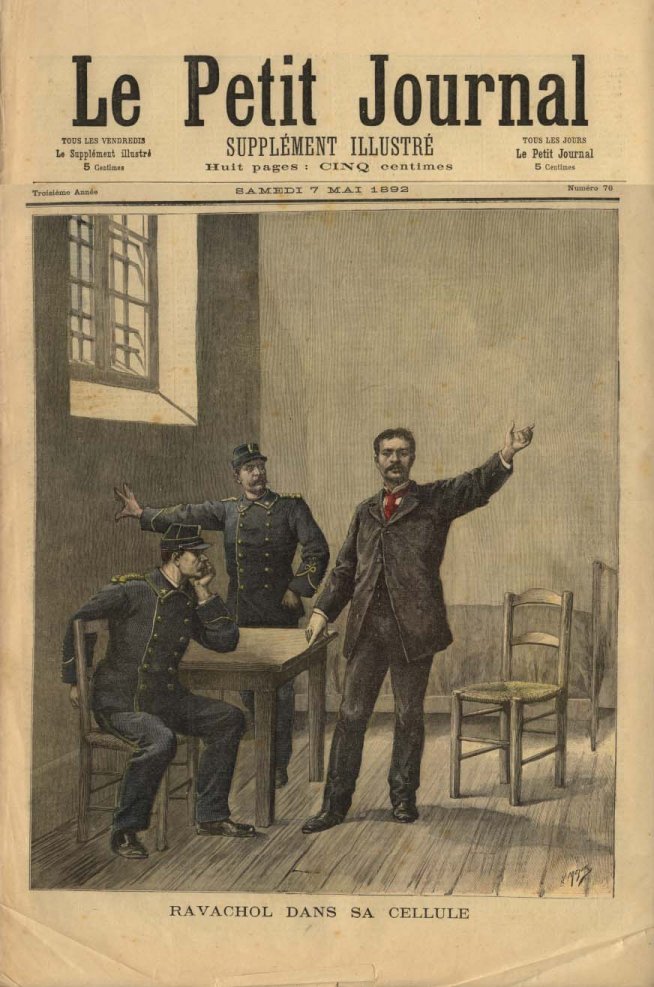
Mes principes.
Cela ne m'étonne pas, répondit-il. La
classe ouvrière, qui comme vous est obligée de travailler pour se
procurer du pain, n'a pas le temps de s'adonner à la lecture des
brochures que l'on met à sa portée; il en est de même pour vous.
L'anarchie, c'est l'anéantissement de
la propriété.
Il existe actuellement bien des choses
inutiles, bien des occupations qui le sont aussi, par exemple, la
comptabilité. Avec l'anarchie, plus besoin d'argent, plus besoin de
tenue de livres et d'autres emplois en dérivant.
Il y a actuellement un trop grand
nombre de citoyens qui souffrent tandis que d'autres nagent dans
l'opulence, dans l'abondance. Cet état de choses ne peut durer; tous
nous devons non seulement profiter du superflu des riches, mais encore
nous procurer comme eux le nécessaire. Avec la société actuelle il est
impossible d'arriver à ce but. Rien, pas même l'impôt sur les revenus ne
peut changer la face des choses et cependant la plupart des ouvriers se
persuadent que si l'on agissait ainsi, ils auraient une amélioration.
Erreur, si l'on impose le propriétaire, il augmentera ses loyers et par
ce fait se sera arrangé à faire supporter à ceux qui souffrent la
nouvelle charge qu'on lui imposerait. Aucune loi, du reste, ne peut
atteindre les propriétaires car étant maîtres de leurs biens on ne peut
les empêcher d'en disposer à leur gré. Que faut-il faire alors? Anéantir
la propriété et, par ce fait, anéantir les accapareurs. Si cette
abolition avait lieu, il faudrait abolir aussi l'argent pour empêcher
toute idée d'accumulation qui forcerait au retour du régime actuel.
C'est l'argent en effet le motif de
toutes les discordes, de toutes les haines, de toutes les ambitions,
c'est en un mot le créateur de la propriété. Ce métal, en vérité, n'a
qu'un prix conventionnel né de sa rareté. Si l'on n'était plus obligé de
donner quelque chose en échange de ce que nous avons besoin pour notre
existence, l'or perdrait sa valeur et personne ne chercherait et ne
pourrait s'enrichir puisque rien de ce qu'il amasserait ne pourrait
servir à lui procurer un bien-être supérieur à celui des autres. De là
plus besoin de lois, plus besoin de maîtres.
Quant aux religions, elles seraient
détruites puisque leur influence morale n'aurait plus lieu d'exister. Il
n'y aurait plus cette absurdité de croire en un Dieu qui n'existe pas
car après la mort tout est bien fini. Aussi doit-on tenir à vivre, mais,
quand je dis vivre, je m'entends. Ce n'est pas piocher toute une journée
pour engraisser ses patrons et devenir, en crevant de faim, les auteurs
de leur bien-être.
Il ne faut pas de maîtres, de ces gens
qui entretiennent leur oisiveté avec notre travail, il faut que tout le
monde se rende utile à la société, c'est-à-dire travaille selon ses
capacités et ses aptitudes; ainsi un tel serait boulanger, l'autre
professeur, etc. Avec ce principe, le labeur diminuerait, nous n'aurions
chacun qu'une heure ou deux de travail par jour. L'homme, ne pouvant
rester sans une occupation, trouverait une distraction dans le travail;
il n'y aurait pas de fainéants et s'il en existait leur nombre serait
tellement minime qu'on pourrait les laisser tranquilles et les laisser
profiter sans murmurer du travail des autres.
N'ayant plus de lois, le mariage
serait détruit. On s'unirait par penchant, par inclinaison et la famille
se trouverait constituée par l'amour du père et de la mère pour leurs
enfants. Si par exemple, une femme n'aimait plus celui qu'elle avait
choisi pour compagnon, elle pourrait se séparer et faire une nouvelle
association. En un mot, liberté complète de vivre avec ceux que l'on
aime. Si, dans le cas que je viens de citer, il y avait des enfants, la
société les élèverait c'est-à-dire que ceux qui aimeraient les enfants,
les prendraient à leur charge.
Avec cette union libre, plus de
prostitution. Les maladies secrètes n'existeraient plus puisque
celles-ci ne naissent que de l'abus du rapprochement des sexes, abus
auquel est obligée de se livrer la femme que les conditions actuelles de
la société forcent à en faire un métier pour subvenir à son existence.
Ne faut-il pas pour vivre de l'argent à tout prix !
Avec mes principes que je ne puis en
si peu de temps vous détailler à fond, l'armée n'aurait plus raison
d'être puisqu'il n'y aurait plus de nations distinctes, les propriétés
étant détruites et toutes les nations s'étant fusionnées en une seule
qui serait l'Univers.
Plus de guerres, plus de querelles,
plus de jalousie, plus de vol, plus d'assassinat, plus de magistrature,
plus de police, plus d'administration.
Les anarchistes ne sont pas encore
entrés dans le détail de leur constitution, les jalons seuls en sont
jetés. Aujourd'hui les anarchistes sont assez nombreux pour renverser
l'état actuel des choses, et si cela n'a pas lieu c'est qu'il faut
compléter l'éducation des adeptes, faire naître en eux l'énergie et la
ferme volonté d'aider à la réalisation de leurs projets. Il ne faut pour
cela qu'une poussée, que quelqu'un se mette à leur tête et la révolution
s'opérera.
Celui qui fait sauter les maisons a
pour but d'exterminer tous ceux qui par leurs situations sociales ou
leurs actes sont nuisibles à l'anarchie. S'il était permis d'attaquer
ouvertement ces gens-là sans crainte de la police et par conséquent pour
sa peau on n'irait pas détruire leurs habitations à l'aide d'engins
explosibles, moyens qui peuvent tuer en même temps qu'eux la classe
souffrante qu'ils ont à leur service.
Enfance et adolescence.
Je suis né à Saint-Chamond (Loire) le
14 octobre 1859, de parents hollandais et français.
Mes parents vivaient, je crois,
séparés, mais ils avaient la ferme intention de s'unir, le retard de
cette union ne dépendait que des formalités à remplir (acte de naissance
etc., de mon père hollandais).
Mon père était lamineur, ma mère était
moulinière en soie. A ce moment, ils étaient dans une petite aisance,
car ma mère avait reçu quelque peu d'argent de sa famille, mais mon père
avait des dettes qu'il fallut éteindre.
J'ai été élevé en nourrice jusqu'à
l'âge de trois ans et d'après les dires de ma mère, je n'ai pas eu tous
les soins nécessaires pour un jeune enfant.
A ma sortie de nourrice, je fus placé
à l'asile et y suis resté jusqu'à l'âge de six ou sept ans.
Mon père battait ma mère et me faisait
des questions pour faire des rapports contre elle, ce à quoi je ne
répondis jamais, et par suite du désaccord dans le ménage, il
l'abandonna avec quatre enfants, dont le plus jeune avait trois mois.
Il s'en alla dans son pays, mais comme
il était atteint d'une maladie de poitrine, il succomba au bout d'un an.
Berger.
Ma mère ne pouvait subvenir à
l'existence de quatre enfants et me plaça à la campagne (La Rivoire près
de Saint-Chamond) chez Mr. Loa, mais il ne put me garder car j'étais
trop petit pour attacher ou détacher les vaches qu'il avait et je revins
près de ma mère, attendre l'année suivante.
Ma mère allait demander l'assistance
aux gens aisés et elle m'envoyait quelquefois chercher soit de l'argent
ou du pain.
Un jour, je me souviens, que l'on
donna à ma mère un costume de collégien, je ne voulus pas le porter tel
qu'il était de peur que les autres enfants me disent que c'était un
vêtement de mendicité, et il fallut que ma mère enlevât tous les boutons
et tout ce qui pouvait faire soupçonner ce don.
Nous vécûmes tous bien tristement, et
l'année suivante je repris le chemin de la campagne et retournai chez
Mr. Loa, qui me payait 15 francs pour la saison.
Je n'avais alors que huit ans, et
j'aidais mon maître qui n'avait que moi de domestique, à engerber le
foin sur les voitures, en mot aux travaux de fenaison.
Le dimanche, j'assistais aux offices
religieux, en somme je suivais les principes qui m'avaient été inculqués
par nies parents.
L'hiver, je revins dans ma famille, et
je continuai à aller à l'école.
L'année suivante je suis allé dans la
montagne, à la Barbanche chez Liard, où je gardais six vaches et
quelques chèvres.
Le travail me semblait plus pénible
surtout que j'y suis resté le commencement de l'hiver.
Cet hiver me frappa pour plusieurs
raisons : la première fut les souffrances que j'endurais du froid pour
mener les chèvres brouter la pointe des genêts, et étant mal chaussé,
j'avais les pieds pour ainsi dire dans la neige, la deuxième, la perte
d'une de mes sœurs, la plus jeune, et une maladie que je fis, la fièvre
muqueuse.
L'année suivante, je suis allé pendant
l'été chez un gros fermier Mr. Bredon, meunier et marchand de bois dans
la commune d'Izieux. J'avais 4 chevaux, 8 vaches et 4 bœufs, un
troupeau de brebis et quelques chèvres. Je gardais les vaches et les
bœufs, c'était en 1870, j'avais onze ans.
Je crois que ce fut cet hiver que je
fis ma première communion chez mes parents.
Quelquefois en gardant les vaches, je
pleurais en souvenir de ma petite sœur que j'avais perdue. Je me
souviens que ma mère vint me voir, elle était malade, et j'ai beaucoup
pleuré lorsque je l'ai vue s'en aller en me laissant dans des mains
étrangères, et aussi parce que je la savais malade et malheureuse.
L'année suivante, je suis allé à la
Brouillassière entre Val Fleury et Saint-Chamond, mon patron M. Paquet
était brutal pour les animaux et tenait une ferme appartenant à
l'hospice et était un peu dans la misère, je n'y étais pas trop
malheureux.
En revenant passer l'hiver à la
maison, je me suis embauché par l'intermédiaire de maman dans un atelier
de fuseaux où je gagnais 10 sous par jour, et à la belle saison je suis
retourné à la campagne à Gray dans la montagne. Là j'étais bien vu de
mes patrons que j'aimais beaucoup.
J'y ai passé l'été et l'hiver et cela
avec plaisir, car ils avaient un fils très instruit avec qui j'étais
content, de causer. Si je n'y suis pas resté, c'est à cause des faibles
appointements qu'ils me donnaient, car je gagnais trop peu pour acheter
même des vêtements.
Le jour même que je les quittai pour
aller à Saint-Chamond, j'ai rencontré sur la route un cantonnier à qui
j'ai exposé ma situation. Alors il m'a dit qu'il connaissait un paysan
qui cherchait un berger. Il m'expliqua que je le trouverais sans doute à
Obessa, en effet je l'y trouvai et fus embauché pour les gages de 80
francs.
Je suis parti avec lui, et j'ai passé
la nuit chez lui, le lendemain je suis venu à pied chez moi, et j'appris
par ma mère qu'il y avait un paysan tout près de Saint-Chamond qui
cherchait un berger, alors j'ai cédé aux instances de ma mère et me suis
rendu chez le fermier que ma mère m'avait indiqué, car celui de la
Fouillouse ne m'avait pas donné d'arrhes, autrement je serais allé chez
lui, d'autant plus qu'ayant moins de bêtes à garder, j'aurais eu moins
de mal que chez l'autre, et ce fut la dernière fois que je fus berger.
Je me rappelle un fait sans
importance, mais qui peut faire connaître l'avarice de mon patron. Un
jour il me dit : « dépêchons-nous de manger, nous mangerons mieux à la
maison »; ce à quoi je répondis : « — à la maison ou ici, vous me dites
la même chose, car vous êtes toujours à nous presser, et à nous
commander du travail au moment des repas de manière que nous n'ayions
pas le temps de prendre notre nécessaire. »
Il voulut me rembaucher pour l'année
suivante, mais j'ai refusé, voulant apprendre un état autre que
cultivateur.
Arrivé chez moi, je suis allé
travailler quelques jours dans une mine de charbon pour trier les
pierres, je gagnais 15 sous par jour. De là je suis allé je crois chez
des cordiers pour tourner la roue. j'y étais assez bien, gagnant de 0,75
à 1 franc; en sortant de là, je suis allé chez des chaudronniers en
fonte, je chauffais les rivets et frappais devant, je gagnais 1 franc
par jour. Le bruit m'assourdissant, je fus obligé de partir.
Apprenti teinturier.
Ma mère m'embaucha alors comme
apprenti teinturier chez Puteau et Richard à Saint-Chamond.
J'ai dû faire trois ans
d'apprentissage et un apprentissage pour ainsi dire nul, puisque l'on
cachait le secret des opérations, et il fallait pour en savoir quelques
mots, surprendre les ouvriers pendant le travail et questionner les
camarades pendant que les contremaîtres n'étaient pas là.
On ne voulait pas que les apprentis
mettent la main à la pâte; pour apprendre ils devaient seulement
regarder quand ils avaient le temps, car on ne voulait pas sacrifier une
pièce de soie pour les apprendre et il fallait qu'ils produisent d'une
autre manière. Je me souviens que nous profitions de l'heure des repas
des contremaîtres pour nous exercer et nous perfectionner.
La première année je touchais 1,50 F
par jour, la deuxième 2 F, la troisième, pendant six mois 2,45 F, et les
six autres mois 2,50 F.
Nous faisions assez souvent sans
augmentation de salaire douze à treize heures de travail.
On exigeait de nous un travail
au-dessus de nos forces, et on nous faisait soulever des poids que des
hommes maniaient difficilement.
Les dimanches, jusqu'à l'âge de seize
ans, le soir, j'allais de temps en temps avec des camarades au bal, la
seule distraction de Saint-Chamond.
Je ne suis allé que très rarement au
café, parfois on se réunissait quelques camarades pour aller faire un
tour à la campagne, ou on allait chez l'un ou chez l'autre pour
apprendre à danser.
Ce fut à peu près ma vie pendant mes
dernières années d'apprentissage, je dépensais à peu près 15 sous par
dimanche.
Ma mère avait repris son travail avec
plus d'ardeur lorsqu'elle eut placé mon frère aux enfants assistés,
n'ayant conservé que ma sœur auprès d'elle, mais, comme mon frère se
plaignait des Frères qui le gardaient, ma mère le reprit lorsque je fus
ouvrier; j'avais alors dix-neuf ans.
Ouvrier et militant.
Je suis resté six mois ouvrier dans la
maison où j'ai fait mon apprentissage aux appointements de 3,75 F au
lieu de 4 F comme l'indiquait le règlement de la maison, mais sachant
que je n'étais pas expérimenté dans la partie je n'osais quitter la
maison, et il a fallu qu'on me renvoie pour perte de temps causée par
notre bavardage et nos ris entre camarades.
De là, je suis allé au Creux commune
d'Izieux, à la maison Journoux, mais comme je n'étais pas très fort
ouvrier, il me donnait 3,90 F au lieu de 4 F; j'y suis resté une dizaine
de mois, jusqu'à la grève.
J'assistais à toutes les réunions des
grévistes qui n'eurent pas gain de cause; la grève dura environ trois
semaines.
Pendant ce temps je vécus sur mes
économies; dès le début de la grève je fus renvoyé avec tous mes
camarades.
Je partis un soir à 9 heures, pour
Lyon, et cela pédestrement, avec un camarade, Jouany, natif de
Saint-Chamond.
A deux heures du matin, éreintés par
la marche, nous nous sommes couchés sous un arbre, mais nous nous sommes
réveillés vers 4 heures du matin à cause du froid et avons poussé
jusqu'à Givors, pensant trouver un train, mais comme c'était trop bonne
heure, nous avons marché jusqu'à Grigny, là dans un café nous avons
cassé la croûte en attendant le train, c'est moi qui ai réglé les
dépenses. Après le repas, nous avons pris le premier train pour Lyon,
nous nous sommes embauchés tous les deux dans une teinturerie de soie,
en noir (à la montée de la butte), nous y sommes restés quelque temps,
et quand la grève de Saint-Chamond a été terminée, beaucoup de nos
camarades y sont rentrés, bien qu'ils n'aient pas eu gain de cause.
Ne voulant céder à la volonté des
patrons, je suis resté à Lyon et suis rentré dans un autre atelier où on
gagnait 4,50 F par jour, c'est-à-dire 0,50 F de plus (maison Coron, rue
Godefroy, teinturerie en couleurs).
Je n'y suis pas resté longtemps, le
travail ayant baissé, et mon camarade ayant été renvoyé avant moi.
Chômeur.
Je me suis trouvé sans travail pendant
un mois, car n'étant ouvrier qu'en noir, je m'embauchais difficilement.
Voyant que je ne trouvais pas d'embauche, je suis retourné chez ma mère
car je n'avais plus qu'une trentaine de francs en poche.
J'avais fait connaissance d'une jeune
fille avant de partir de Saint-Chamond, que j'aimais beaucoup et qui
m'écrivait souvent, pendant mon séjour à Lyon, de revenir auprès d'elle,
mais je retardais toujours pensant pouvoir faire quelques économies pour
m'habiller convenablement.
Elle est même venue me voir à Lyon, et
j'ai eu le plaisir de passer une nuit auprès d'elle. Je m'étais permis,
avant de connaître cette jeune fille, de faire quelques fredaines en
sortant du bal, mais ce ne fut que des amours d'un jour.
À Saint-Chamond, le travail marchait
peu, je restai donc sans travail encore quelque temps, et par conséquent
à la charge de ma mère.
Un jour je rencontre un ouvrier de
connaissance qui travaillait dans une usine métallurgique, chez les
Potin; il m'invita à aller avec lui. J'acceptai avec empressement.
Arrivés au portail de l'usine, il
fallut attendre que l'on vienne choisir les hommes qui plaisaient.
À ce moment, on rentrait un cylindre.
Comme le chemin était en pente, on avait mis des hommes derrière la
voiture pour retenir en cas d'accident; j'ai profité de l'occasion et me
suis mis avec ceux qui faisaient la corvée, et une fois dans l'atelier,
je me suis présenté au contremaître ou directeur, Mr. Pernod, et j'ai
été de suite accepté avec un autre du pays, mais pas celui qui m'avait
suggéré l'idée d'aller à cet atelier, car lui, étant resté à la porte,
n'avait pas été embauché.
J'ai travaillé comme manœuvre à
plusieurs machines entre autres la cisaille, à raison de 3 F par jour.
Bagarreur.
Le cinquième jour que je m'y trouvais,
c'était je crois le jour de l'an, dans un moment de repos, et pendant
que je dormais, un garçon de four sortant des dragons, vient pour me
jeter un seau d'eau à la figure. Je l'entendis; aussitôt je me levai sur
mon séant et l'ai interpellé. Alors voulant boxer avec moi, je lui
envoyai un coup de poing par la figure jusqu'à ce qu'il fut content de
la distribution, et comme mon père s'était rendu célèbre par les volées
qu'il avait données à plusieurs et au contremaître Humbert, tous les
ouvriers voulurent voir le fils de l'allemand, comme on l'appelait,
après la scène que je venais d'avoir.
J'ai oublié de dire qu'une pareille
affaire m'était arrivée à Saint-Chamond et que j'avais eu aussi gain de
cause; c'est de là que ma réputation d'homme à redouter en cas de
dispute se fit.
À mon retour à Saint-Chamond, je
reliai connaissance avec la jeune fille dont j'ai parlé, et je ne l'ai
abandonnée qu'avec beaucoup de peine lorsqu'elle m'apprit que nos
relations ne pouvaient plus continuer, puisqu'elle était courtisée en
vue du mariage, par le fils de son patron.
Je suis resté dans cette usine cinq
mois environ et en suis sorti volontairement pour m'embaucher chez
Pichon teinturier à Saint-Chamond.
Je perds la foi.
J'avais commencé à lire le Juif
errant d'Eugène Sue chez Journoux, lorsque j'avais dix-huit ans.
La lecture de ce volume avait commencé
à me montrer odieuse la conduite des prêtres : je plaignais amèrement
les deux jeunes filles et leur compagnon Dagobert.
Or un jour une conférence fut faite à
Saint-Chamond par Mme Paule Minck, collectiviste.
Elle traita des idées religieuses, les
combattit, en un mot elle fit une conférence anticléricale. D'après
elle, pas de Dieu, pas de religion, du matérialisme complet. Elle disait
que saint Gabriel était un joli garçon qui faisait la cour à celle que
l'on appelle la Vierge, et que saint Joseph n'était que son époux pur et
simple.
J'ai été très frappé de ses discours,
et déjà poussé par le Juif errant contre la religion, je n'ai
plus eu confiance, et j'ai à peu près complètement perdu les idées
religieuses.
Dans un cercle d'études sociales.
Quelque temps après, Léonie Rouzade,
collectiviste, et Chabert de même parti, c'est-à-dire le Parti ouvrier,
firent une conférence à Saint-Chamond à laquelle j'ai assisté.
Le sujet de la femme était
anticlérical, et l'homme traita la question sociale.
Tous ces discours m'ébranlèrent, et à
la sortie de cette réunion, j'ai demandé à mon ami Nautas s'il y avait
des écrits qui traitaient ces matières. Il me répondit que oui, que le
journal Le Prolétariat imprimé à Paris me mettrait au courant de
toutes ces questions.
Sur ces entrefaites, je fis
connaissance d'un autre camarade qui avait eu une discussion énergique
avec le maire de Saint-Chamond, M. Chavannes, qui a été député.
Je trouvais étrange qu'un ouvrier
discutât aussi vertement avec un maire, car ces deux personnages
sortaient de la conférence avec moi. Cet ouvrier s'appelait Père.
J'ai cherché à causer avec cet homme
qui avait pris la parole pour notre grève des teinturiers. Je parvins à
le voir, et il m'apprit qu'un cercle d'études sociales était en
formation. Je lui demandai si je pourrais en faire partie, il me
répondit affirmativement et me donna quelques explications. Depuis lors
j'en fis partie.
Ce qui m'avait tant poussé à continuer
l'étude des problèmes sociaux, c'était aussi la première lecture du
Prolétaire qui parlait en faisant l'apologie de la Commune de 1871, et
des victimes du nihilisme russe. Je l'avais tellement lu et relu, que je
le savais presque par cœur. J'avais alors vingt à vingt et un ans. Je
lisais aussi un journal quotidien collectiviste Le Citoyen de Paris.
Dès le début, je comprenais difficilement leurs idées, mais en
persévérant je suis parvenu à voir qu'elles étaient bonnes.
Je
deviens anarchiste.
Dans le cercle dont je faisais partie,
il venait souvent des orateurs anarchistes qui, prenant la parole,
m'éclairaient sur les points que je ne comprenais pas.
Bordat, Régis Faure, m'ouvrirent un
autre genre d'idées. De prime abord je trouvai leurs théories
impossibles, je ne voulais pas les admettre, mais à force de lire les
brochures collectivistes et anarchistes, et avoir entendu maintes
conférences, j'optai pour l'anarchie sans toutefois être complètement
convaincu sur toutes leurs idées.
Ce ne fut que deux ou trois ans après
que je devins complètement de l'avis de l'anarchie.
Premiers démêlés avec la justice.
Je suis resté chez Pichon, à peu près
deux ans et demi, j'ai été renvoyé de cette maison parce que j'ai eu
quelques minutes de retard à la rentrée du travail du matin, et j'ai
répondu au contremaître qui m'en faisait l'observation qu'il ne comptait
pas les jours où je restais après l'heure. C'est à cause de ces paroles
qu'il me donna mes trois jours pour me retirer.
C'est après cette affaire que je fis
maison sur maison à cause du manque de travail, chez Vindrey, chez
Balme, chez Cuteau et Richard. Je suis retourné trois fois chez Vindrey,
j'ai travaillé sur ces entrefaites chez Coron à Saint-Étienne, pendant
un mois. C'est chez Vindrey que je suis resté le plus longtemps.
Je fréquentais alors les cours du
soir, primaires et de chimie, et j'ai même fait une demande pour être
admis à suivre les cours de jour pendant les jours de chômage,
autorisation qui m'a été refusée parce que j'étais trop vieux.
J'apprenais difficilement et ne
comprenais qu'après que l'on m'eût expliqué plusieurs fois. C'est là que
j'appris un peu de calcul.
Étant chez Vindrey, j'étais
anarchiste, je commençais à faire des explosifs, mais je n'arrivais pas
à fabriquer des engins convenables, n'ayant que de mauvaises matières
entre les mains; je cherchais à faire de la dynamite. Un de mes amis,
qui avait acheté dans une vente de l'acide sulfurique ne put le garder
chez lui, car un de ses enfants avait failli se brûler avec, il me le
donna.
Un jour, une fille qui avait été
trompée par son amant, vint me trouver sachant que j'avais à ma
disposition du vitriol, ou pour mieux dire acide sulfurique, et m'en
demanda pour brûler un cor qu'elle avait. Je me défiais, et je lui
demandai comment elle l'employait. Elle me répondit qu'elle en prenait
une goutte avec une paille, et le mettait sur le cor, que ce procédé lui
avait déjà réussi. Alors je lui en ai donné très peu dans un grand
récipient, mais elle s'en est servi en y ajoutant un peu d'eau, pour le
jeter à la face de son amant.
Cette femme fut arrêtée et on lui
demanda où elle avait eu cet acide, elle dit que c'était moi qui lui
avais donné. Je fus donc appelé auprès du Commissaire de Police; là,
l'affaire s'expliqua et je fus relâché après avoir été entendu.
La police a dû sans doute aller
prendre des renseignements à ce sujet sur moi chez mon patron M. Vindrey,
car dès qu'il eût appris que j'étais anarchiste, il renvoya d'abord mon
frère et ensuite moi, et cela immédiatement. J'eus beau lui demander des
explications il ne me répondit pas, mais à force d'injures et
d'insultes, je lui arrachai cet aveu : que s'il m'avait connu il y
aurait déjà longtemps qu'il m'aurait mis à la porte.
Je ne pouvais laisser mourir de faim ma mère...
A ce moment ma sœur venait d'avoir un
enfant avec son amant. Nous étions sans travail, mon frère et moi et
sans un sou d'avance. Nous n'avions que le pain que le boulanger voulait
bien nous donner. Ne trouvant de travail nulle part, je fus obligé
d'aller en quête de nourriture.
Je prenais un pistolet et j'allais à
la campagne à la chasse aux poulets avec un panier à la main pour les
mettre, je faisais semblant de ramasser des pissenlits. Mon frère allait
voler des sacs de charbon. Un jour même il faillit se blesser en sautant
un mur avec un sac, étant poursuivi. Ce charbon on le prenait parmi les
déchets.
Il m'était pénible d'aller prendre la
volaille à de malheureux paysans, qui peut-être n'avaient que cela pour
vivre, mais je ne savais pas ceux qui étaient riches et je ne pouvais
pas laisser mourir de faim ma mère, ma sœur et son enfant, mon frère et
moi.
J'ai bien cherché à travailler, mais
partout on me renvoyait, ma mère et ma sœur ignoraient d'où provenait la
volaille que j'apportais, je leur disais que j'avais donné un coup de
main à des paysans et qu'ils m'avaient donné une poule en paiement. Je
fus obligé d'agir ainsi durant à peu près un mois, c'est-à-dire jusqu'au
mois de mai, où je suis parti pour Saint-Etienne.
Une fois du travail à peu près assuré,
mon frère s'est aussi embauché et ma mère vint me rejoindre. Mon frère
gagnait beaucoup plus que moi mais dépensait davantage, il ne rapportait
presque rien à la maison.
Un jour je lui en fis le reproche et
même plusieurs fois, en lui disant : « Que ferions-nous à la maison, si
j'en faisais autant que toi; demain nous n'aurions qu'à regarder la
table » et je lui fis la morale. Il se mit à pleurer sentant le reproche
juste, mais cela ne le corrigeait pas, qu'il gagne peu ou beaucoup.
J'avais appris à jouer de l'accordéon,
et le dimanche quand j'en trouvais l'occasion, j'allais faire danser,
cela me permettait d'avoir quelques sous devant moi, pour pourvoir à mes
dépenses personnelles, car je remettais toute ma paie entre les mains de
ma mère pour laquelle j'avais alors beaucoup d'affection, affection
qu'elle perdit plus tard à cause de son bavardage et de ses cancans au
sujet d'une maîtresse que je fis par la suite.
Contrebandier.
Au bout de deux ans que j'étais à
Saint-Étienne, je me mis à faire de la contrebande pour les alcools, car
mon travail ne pouvait me suffire à cause des jours trop nombreux de
chômage.
Au moyen d'appareils en caoutchouc qui
s'adaptaient à la conformation du corps, je passais les liquides soit en
tramway soit à pied. Je portais sur moi des fioles d'odeur de manière
que les personnes qui m'approchaient sentissent le goût des parfums au
lieu de celui des émanations de l'alcool.
Cette idée m'avait été suggérée par un
camarade qui m'avait fourni l'argent et les indications nécessaires.
Quelque temps après je fis
connaissance d'une femme mariée, par l'intermédiaire de ma mère.
Celle-ci, qui allait aux conférences des protestants, parla à cette
femme beaucoup en ma faveur, comme du reste toutes les mères font. Ma
mère avait fait cela croyant parler à une demoiselle.
Or, un dimanche, elle l'invita à venir
chez nous. J'étais endimanché et prêt à sortir. En voyant cette petite
brune aux grands yeux noirs, je compris que c'était la personne dont ma
mère m'avait parlé, et je fus galant avec elle, autant que ma faible
éducation me le permettait. Il nous resta à cette dame et à moi, une
bonne impression de notre entrevue; j'appris qu'elle était mariée avec
un ouvrier passementier âgé de vingt ans de plus qu'elle.
Les relations commencèrent, d'abord
amicales et ensuite intimes. Elle avait deux enfants, un garçon de douze
ans et un autre de sept ans, qui était estropié.
Je compris que cette femme était
malheureuse avec son mari qui jamais ne lui causait, et dont, à cause de
la différence d'âge, le caractère était bien contraire, lui était
renfermé et grossier, elle expansive et affectueuse.
Je conçus l'idée de lier pour toujours
ma vie avec cette femme; je lui exposai ces idées et mes théories,
c'est-à-dire qu'il lui était permis comme à moi de céder, lorsqu'elle le
voudrait, à un penchant d'amour. Je lui autorisais même à recevoir chez
nous ceux pour lesquels elle avait un penchant. Il en aurait été de même
pour moi, sans que cette conduite détruisît notre union; seulement, nous
devions agir par respect l'un pour l'autre, avec discernement, en tenant
secrets les rapports étrangers à la maison, de telle sorte que l'on ne
fasse pas naître dans le cœur de l'un ou de l'autre la jalousie, fille
de la peine spontanée du cœur.
Cette femme s'appelait Bénédicte.
Comme sa situation était très précaire, je lui donnais de l'argent dans
la mesure du possible. J'étais donc obligé pour ainsi dire par
l'affection que je lui portais, à continuer la contrebande pour lui
venir en aide et avoir quelque argent devers moi. Elle ne sut que très
tard que je faisais la contrebande car je ne pouvais pas toujours lui
dissimuler ce que je faisais d'autant plus qu'elle se trouvait souvent
dans la chambre où je retirais mes appareils.
Ma mère apprit bientôt cette relation,
et excitée par les voisines et sachant cette femme mariée, elle fit tout
son possible pour briser cette union de cœur.
Elle l'insultait plus bas que terre en
pleine rue, et accompagnait ses paroles de menaces. Ceci m'indisposa
fort contre ma mère et malgré toutes les conciliations possibles que je
fis auprès d'elle, elle ne faisait que continuer de plus belle. C'est
alors que mon amour filial se changea en haine, et que je m'attachai de
jour en jour avec plus de force à ma maîtresse.
Faux-monnayeur.
Voyant que la contrebande ne
produisait plus beaucoup et que le travail ne marchait pas, je résolus
de faire de la fausse monnaie, car je me rappelais qu'un de mes amis en
avait fait et que cela avait réussi; cet ami se nommait Charrère.
Je commençai à faire des pièces de 1 F
et de 2 F, quelques-unes de 5 F, et de 0,50 F. J'en ai écoulé quelque
peu; je trouvai trop méticuleux la fabrication et trop difficile
l'écoulement.
Pourtant, je voulais faire le bonheur
de ma maîtresse et le mien, nous mettre pour l'avenir à l'abri de toute
misère. L'idée du vol en grand me vint à l'esprit. Je me disais
qu'ici-bas nous étions tous égaux et nous devions avoir les mêmes moyens
pour se procurer le bonheur.
Profanateur.
Abandonné de toutes ressources, dénué
de tout et sachant qu'il y avait actuellement assez de choses de
produites pour satisfaire à tous les besoins d'un chacun, je cherchais
quelle était la chose qui pouvait me procurer le bien-être. Or, je ne
voyais que l'argent, je ne désirais en posséder que pour mes moyens
d'existence de chaque jour, et non pour le bonheur d'être dans
l'opulence et regorger d'or.
Je me mis donc en quête de savoir où
je pourrais frapper, ne pouvant me résigner à crever de faim à côté de
gens qui étaient dans le superflu.
J'appris qu'à Notre-Dame-de-Grâce il y
avait un vieillard qui vivait dans la solitude et qui recevait beaucoup
d'aumônes. Sa vie était très sobre, et naturellement il devait amasser
un trésor. Je partis une nuit me rendre compte de la véracité de ce que
l'on m'avait dit, explorer la maison et être en état de me présenter de
manière à ne pas échouer dans mon entreprise.
Avant d'avoir pris ces dispositions,
j'appris par des camarades que l'on avait enterré une baronne, Mme de
Rochetaillée, et qu'on avait dû la parer de ses bijoux. J'ai pensé que
je pourrais facilement violer son tombeau et me procurer toutes les
choses de valeur. J'allai donc au cimetière de Saint-Jean-Bonnefonds
(Loire) où était son caveau. Vers 11 heures du soir, j'escaladai le mur
du cimetière. En y allant, j'ai profité de l'occasion pour écouler deux
pièces de 2 F. Je pus en faire passer une chez un marchand de vins, et
l'autre chez un boulanger, car je ne voulais pas être sans argent dans
ma poche. Une fois le mur escaladé, j'ai cherché l'endroit de la
sépulture, que j'ai trouvé facilement. La pierre tombale était située
devant la chapelle mortuaire. A l'aide d'une pince-monseigneur prise, je
crois, dans un chantier, je parvins difficilement à soulever la pierre,
puis j'ai rentré dans le caveau. Dans le caveau, il y avait plusieurs
cases fermées par des plaques en marbre, j'ai cherché celle où il y
avait une indication me donnant l'endroit où reposait la baronne. J'ai
enfoncé ma pince dans un interstice et en secouant de droite à gauche,
je fis tomber la plaque en marbre qui fermait l'entrée de la case. Cette
plaque en tombant produisit un bruit sonore, car il y avait beaucoup
d'écho dans ce caveau. Aussitôt je suis remonté pour voir si ce bruit
n'avait pas attiré l'attention de quelqu'un.
Voyant que je n'avais rien à craindre,
je suis redescendu dans le caveau et j'ai retiré avec beaucoup de peine
le cercueil de sa case qui était la deuxième et placée à 1,20 m de
hauteur, mais n'ayant pu maintenir le cercueil je le laissai tomber. Un
bruit sourd, plus fort que le premier se fit entendre. Je suis remonté
comme la première fois me rendre compte de l'effet produit. Voyant que
je pouvais continuer mon œuvre tranquillement, je suis redescendu et
j'ai commencé à faire sauter les cercles qui entouraient le cercueil, et
toujours à l'aide de ma pince. Je parvins à briser le couvercle, je
rencontrai alors un deuxième cercueil en plomb que je n'eus pas trop de
mal à défoncer. J'avais avec moi une lanterne sourde qui s'éteignit
avant la fin de l'opération.
Je remontai pour aller chercher des
fleurs desséchées et des couronnes fanées que j'allumai dans le caveau
afin de m'éclairer.
Le cadavre commençait à être en état
de décomposition, je ne parvenais pas à trouver les bras, alors j'ai
essayé de débarrasser le cadavre et j'ai trouvé sur le ventre une
quantité de petits paquets que j'enlevai et jetai par terre. Il y en
avait de tous les côtés, et ce travail fait, j'examinai les mains, les
bras et le cou, mais je ne vis pas de bijoux. Ne trouvant rien, et
commençant à être asphyxié par la fumée que produiraient les fleurs et
les couronnes en brûlant, je suis sorti du caveau et me suis en allé par
la porte du cimetière qui ne s'ouvrait qu'intérieurement.
Je repris le chemin de Saint-Étienne,
et j'avais mis une fausse barbe. En route j'ai rencontré un homme qui me
demanda d'un peu loin le chemin de la gare. J'avais sur moi un revolver.
Cet homme, ne comprenant pas bien ce que je lui disais, s'approcha de
moi et me fit la remarque que j'avais une fausse barbe, réflexion qui me
fit sourire. J'arrivai à Saint-Étienne vers 2 heures du matin.
Cambrioleur.
N'ayant pas réussi, je songeai à
trouver autre chose, et j'appris qu'à un petit village appelé « La
Côte » il y avait une maison inhabitée appartenant à des riches. Je crus
qu'il y avait de l'argent; je suis allé trois fois explorer les lieux de
manière à opérer sûrement.
Un soir j'y suis allé et ai essayé de
faire sauter la pince. Comme je n'y parvins pas, je suis parti et y.
retournai le lendemain emportant un vilebrequin et une mèche anglaise
très large. J'ai escaladé le mur et j'ai sauté dans le jardin, je me
suis dirigé vers la porte de derrière et me suis mis à l'oeuvre. Lorsque
le trou fut assez grand pour y passer mon bras, je l'enfonçai, enlevai
la barre et ouvrit la crémone, il a même fallu que je m'aide de ma pince
pour faire effort afin de faire sauter le pêne de sa gâche. J'ai visité
la cave où il y avait du vin, des liqueurs, etc., et où, par conséquent,
je me suis rafraîchi, car j'avais eu beaucoup de mal à ouvrir la porte
de la cave, ensuite j'ai visité toutes les chambres jusqu'au grenier.
J'ai trouvé 4 ou 5 F, dans une poche de robe.
J'ai pris des matelas, couvertures et
quelques effets, des pendules, du vin, des liqueurs, de l'eau-de-vie,
une longue-vue, des jumelles, etc.
Je suis retourné pendant trois
semaines environ emportant chaque fois dans un appareil une vingtaine de
litres de vin et des paquets de liqueurs fines. Ayant fait la
contrebande, j'avais la facilité d'écouler les spiritueux. Ensuite je
continuais, les ressources épuisées à vivre tout en faisant la
contrebande soit en fabriquant de la fausse monnaie, jusqu'à l'affaire
de l'Ermitage. Car ceci se passait en mars, et l'affaire de l'Ermite en
juin.
Assassin.

Poussé à bout, ne trouvant pas
d'embauche nulle part, je ne voyais qu'un moyen de mettre fin à mes
maux : aller à Notre-Dame-de-Grâce dépouiller l'ermite et son trésor.
Avant de prendre définitivement cette décision, j'ai cherché à trouver
un emploi, si pénible qu'il fût, dans les mines de Saint-Étienne. Là,
comme chez mes anciens patrons, impossible de trouver de l'occupation.
Ceux mêmes qui étaient du métier ne pouvaient pas rentrer.
Alors désespéré, je partis seul un matin pour Notre-Dame-de-Grâce. Je
pris le train vers 7 heures à Saint-Etienne pour Saint-Victor-sur-Loire,
en changeant de train à Firminy.
N'ayant exploré l'habitation de l'ermite que nuitamment, j'eus quelque
hésitation pour me diriger, alors je demandai, en descendant du train,
au chef de gare le chemin le plus court pour aller à Notre-Dame. En
route, à Chambles, je rencontrai une petite fille à qui je demandai le
nom du hameau que l'on voyait là-haut sur la montagne, et s'il n'y avait
pas un ermite qui y vivait. La réponse ayant été explicative puisqu'elle
me donna le nom du hameau : Notre-Dame-de-Grâce, et qu'elle me montra
l'endroit où demeurait l'ermite, je lui donnai un sou.
En gravissant la montagne, je me suis arrêté à mi-chemin pour casser la
croûte. Je fus en ce moment interpellé par un prêtre qui me fit
remarquer que j'avais tort de m'arrêter auprès d'un buisson, que la
montagne était infestée de reptiles. Ce prêtre devait être, à mon avis,
le curé de Chambles. Il descendit la montagne et moi je continuai à la
gravir.
Arrivé au hameau j'eus un instant d'hésitation ne reconnaissant pas très
bien mon chemin. Je me mis alors en route cherchant à m'orienter et à
donner le change aux paysans qui auraient pu remarquer ma présence. Je
m'amusai même en route à visiter les quelques ruines que je rencontrais.
À midi, je me présentai à la porte d'entrée de l'habitation de l'ermite.
Je frappai à plusieurs reprises afin de me rendre compte s'il y avait
quelqu'un, et avoir un moyen d'introduction dans la maison, mais c'était
en vain, je ne reçus aucune réponse. Je passai donc par le derrière,
j'escaladai le mur du jardin, et m'introduisis dans la maison par la
porte de la cave qui se trouvait entrouverte. Apercevant dans la cave un
escalier, je m'y suis engagé. Cet escalier était fermé par une trappe.
J'ai soulevé celle-ci, et me suis trouvé tout à coup dans une chambre où
reposait l'ermite couché dans son lit.
Réveillé par mes pas, l'ermite s'était assis sur son lit et me demanda :
« Qui est là? » A cette interpellation, je répondis : « Je viens vous
trouver pour faire dire des messes pour un de mes parents qui est mort.
Voici un billet de cinquante francs; prenez vingt francs et rendez-moi
la monnaie. »
Ce billet de cinquante francs, je l'avais emprunté à un de mes camarades
avant de quitter Saint-Étienne. Je pensais qu'en l'obligeant à changer
un billet, je verrais l'endroit d'où il sortirait la monnaie à rendre,
et qu'il me servirait comme cela, sans s'en douter, d'indicateur de la
fameuse cachette de son trésor.
Il me répondit d'un air méfiant ces mots entrecoupés : « Non... non! »
Voyant cela, je me suis mis à examiner attentivement la chambre.
L'ermite voulut se lever, mais je lui dis : « Restez au lit, mon brave,
restez au lit. »
Il voulut se lever malgré tout, je m'approche aussitôt du lit, et lui
mettant la main sur la bouche, je lui dis : « Restez donc au lit, nom de
Dieu. »
Malgré cette injonction impérieuse, il voulut toujours se lever. Alors
je lui ai appuyé plus fortement sur la bouche en me servant de mes deux
mains. Comme il se débattait, j'ai saisi le traversin, le lui ai
appliqué sur la bouche et ai sauté sur le lit. Alors par le poids de mon
corps, la pression de mon genou sur sa poitrine, et celle de mes deux
mains appuyant fortement sur le traversin, je parvins à le maîtriser.
Mais ces moyens n'étaient pas assez expéditifs pour obtenir une
suffocation capable de mettre hors de combat cet homme et l'empêcher de
me nuire. Je pris alors mon propre mouchoir, et lui enfonçai dans la
gorge aussi profondément que possible. Il commença bientôt à étirer ses
membres avec des mouvements nerveux, fit même ses excréments pendant que
je le tenais ainsi, et ne tarda pas à rester dans un état d'immobilité
la plus complète. Quand je vis qu'il ne remuait plus, j'enlevai mon
mouchoir, le remis en poche, et sautai au bas du lit.
J'ôtai de suite mes chaussures, pour ne pas faire de bruit, et après
avoir déposé mon revolver auprès du lit, j'ai visité tranquillement tous
les meubles, garde-robe, etc. Partout je trouvais de l'argent de caché,
je fis même sauter avec une pelle que j'ai trouvée sous ma main trois ou
quatre buffets fermés à clef.
Je monte au grenier, je trouve de l'argent partout, le long des
murailles, sur les charpentes, dans des pots, je descends à la cave,
même tableau, de l'argent, toujours de l'argent. Mais jamais, me dis-je
en moi-même, jamais tu n'emporteras tout.
Je pris les mouchoirs de l'ermite, en fis des espèces de sacs en les
nouant, et j'emportai avec moi le plus d'argent possible.
Dans le cours de mes perquisitions, j'entendis frapper à la porte
d'entrée en descendant l'escalier du grenier : j'ai sauté de suite sur
mon revolver que je mis dans ma poche et je prêtai l'oreille un instant.
Comprenant qu'on s'en retournait, je me suis mis à poursuivre mon œuvre.
Cependant je me demandais qui pouvait être venu. Je pensai bientôt que
ça ne pouvait être que la femme du voisin, dont j'entendais à travers la
cloison les pas et le bruit de la voix qui venait voir si l'ermite
n'avait pas besoin de quelque chose, car sans doute cet homme que
j'avais trouvé encore au lit à midi, devait être indisposé.
Vers cinq heures du soir je suis sorti par le même chemin que j'étais
venu, emportant avec moi une charge d'argent et d'or d'au moins vingt
kilos. Je me suis dirigé de suite vers la gare Saint-Victor.
Le train avait beaucoup de retard. Ce retard me permit de me livrer à
mes réflexions. Je compris qu'il n'était pas prudent de continuer la
route avec mon fardeau d'autant plus que le chef de gare avait l'air de
me regarder. Je partis donc au village situé à un kilomètre ou deux, et
sur la route ayant rencontré un conduit qui la traversait, j'y mis de
suite mon butin.
Arrivé au village, j'ai soupé copieusement. La patronne de
l'établissement chercha à lier conversation avec moi en me demandant où
j'allais et d'où je venais. Je lui répondis : « Madame je n'aime pas
d'être interrogé, il n'est pas convenable de faire de telles questions
aux gens, sans savoir si cette manière d'agir leur plaira. » Après
souper, et avoir réglé mon compte, je retournai à Notre-Dame-de-Grâce.
Là, je retournai cinq ou six fois chez l'ermite par les mêmes procédés
que la première fois. A chaque voyage, j'emportais dans mes mouchoirs de
l'argent que je cachais à vingt minutes de là, dans les blés, en ayant
soin toutefois d'écarter les épis, afin de ne laisser aucune trace de
mon passage.
Le matin, je descendis prendre le premier train à Saint-Victor, en
emportant avec moi un paquet rempli de pièces d'argent ou d'or, paquet
que j'ai déposé dans ma chambre en arrivant à Saint-Étienne. C'était le
vendredi. Dans la journée, je vis ma maîtresse et lui demandai si elle
voulait venir avec moi faire une excursion dans la nuit, à la montagne.
Je lui avais dit de prime abord, de ne demander aucune explication au
sujet de cette promenade nocturne. Elle consentit.
Je louai donc une voiture pour toute la nuit.
Au départ, je dis au cocher de prendre la route de Saint-Just-sur-Loire,
en ne lui donnant pas d'autres indications.
Arrivé non loin de mes cachettes, je le fis arrêter et le priai de
m'attendre, en laissant ma maîtresse dans la voiture.
J'avais emporté avec moi une sacoche et une valise en quittant
Saint-Étienne. Je pris ces deux objets avec moi et j'allai vivement
chercher les paquets d'argent que j'avais cachés. A mon retour, je
déposai mes fardeaux sur la route, fis avancer la voiture afin de
m'éviter un parcours plus grand et les déposai dans l'intérieur du
véhicule. Le cocher remarquant que j'avais de la peine à soulever ces
trois objets, me fit remarquer que si c'était de l'argent que je
portais, il y aurait là une somme considérable. Nous reprîmes de suite
le chemin de Saint-Étienne. Tout cela avait demandé beaucoup de temps,
d'autant plus que j'avais été visiter les abords de la maison du crime
pour voir s'il n'y avait rien d'anormal.
Le jour commençait donc à poindre.
En route le cocher me dit : « Gare à l'octroi! » — Je lui répondis :
« Je ne crains rien, je n'ai rien avec moi de soumis aux droits. »
Arrivé à l'octroi, un employé me demanda si j'avais quelque chose à
déclarer. Je lui répondis « Non. » « Du reste, ai-je ajouté :
Regardez. » Il me fit ouvrir la valise, je m'exécutai de suite; il ne
vit que des paquets faits avec des mouchoirs, les tâta et crut sentir un
corps dur. Comme il demandait des explications, je lui répondis que
c'était du métal. Nous reprîmes alors notre route.
La voiture traversa une partie de Saint-Étienne, et me conduisit au
hameau appelé Le Haut Villebeuf jusqu'à la porte de mon habitation, où
nous arrivâmes vers quatre heures du matin. J'ai payé la voiture et ai
donné dix francs de pourboire au cocher, sans toutefois lui faire aucune
observation.
Je montai mon butin dans ma chambre et ma maîtresse me quitta bien vite
afin de rentrer le plus promptement chez elle.
Dans la nuit du samedi, je suis retourné à Notre-Dame-de-Grâce, je pris
le train pour aller et revenir jusqu'à Saint-Rambert, le reste de la
route je le fis à pied. J'avais avec moi une sacoche, je rentrai à la
maison de l'ermite par les mêmes moyens, et la rapportai bondée
d'argent.
Dans l'après-midi du lendemain, qui était le dimanche, j'appris par des
personnes que le crime était connu, et que c'était le perruquier de
l'ermite qui en allant pour le raser, avait découvert l'affaire. J'étais
heureux d'être sorti, car je m'apprêtais à retourner le soir à
Notre-Dame-de-Grâce et mal m'en aurait pris, car j'aurais été évidemment
arrêté sur le fait.
Recherché.
J'achetai de suite des journaux et j'appris
alors que l'on avait su par des employés de l'octroi qu'une voiture
était passée la nuit et qu'on avait déclaré de la ferraille, qu'on
supposait que c'était celle qui contenait le produit du vol, et
qu'actuellement on recherchait le conducteur de cette voiture.
Comprenant qu'on ne tarderait pas à le trouver, je louai de suite une
chambre, et j'y portai toutes les valeurs que j'avais dans celle que
j'occupais alors en portant toutefois une partie de l'argent chez ma
maîtresse, en l'absence de son mari, et l'autre dans ma nouvelle
résidence.
Je résolus d'aller voir le cocher pour le supprimer dans le cas où il ne
serait pas entré dans la voie des aveux, car lui mort, la piste de la
police se trouvait égarée. En allant pour le voir, je le rencontrai en
route avec sa voiture, se dirigeant sur Firminy. Je l'appelai et lui
demandai s'il voulait me conduire à cette localité. Je pensais qu'il ne
pouvait me reconnaître, ayant changé de costume. Il accepta.
Une fois sur la voiture, j'entrai en conversation, et l'amenai sur le
chapitre de l'actualité, je veux dire du crime. « Savez-vous ce que
c'est que cette histoire d'ermite dont on parle? » Il feignit de ne rien
savoir; alors je lui demandai s'il ne pourrait pas me conduire à
Saint-Just-sur-Loire. Je lui faisais la même question que lorsque je le
pris dans la nuit, afin de voir s'il me reconnaîtrait à la voix, ou
encore s'il avouerait quelque chose. Il me répondit négativement, mais
que son patron m'y conduirait. Alors je lui dis : « Ce n'est pas la
peine que vous vous dérangiez pour cela, je ne tiens pas absolument à
aller de suite là-bas, je préfère me rendre immédiatement à
Saint-Étienne pour régler mes affaires. »
A un moment donné, il prétexta avoir oublié quelque chose, me pria de
descendre, et rebroussa chemin en me disant : « Je vais chercher une
note que j'ai oubliée. »
Pas plutôt descendu, je compris que j'étais reconnu, je me mis à suivre
la voiture que je perdis bientôt de vue. Dans ma précipitation et mes
doutes sur l'endroit exact de sa demeure, je dépassai de beaucoup son
habitation, et m'apercevant de mon erreur, j'eus bientôt son adresse
exacte par les habitants du pays, d'autant plus que je connaissais son
nom. Je l'attendis un instant et, ne le voyant pas sortir de chez lui où
je faisais le guet, je compris que le meilleur parti à prendre, était de
m'en retourner chez moi, tout en me tenant sur mes gardes. Je m'en
retournai à pied, ayant mes mains sur les deux revolvers que je portais,
et au moindre bruit, je me mettais sur la défensive.
Tout me portait ombrage et je ne voulus pas me rendre à la gare,
craignant d'être pris, bien que j'avais sur moi un billet de retour pour
Saint-Etienne. En réfléchissant de plus en plus sur la conversation du
cocher et sur ses agissements, je compris qu'il avait déjà depuis
longtemps dévoilé tout ce qu'il savait.
Mon plan était de ne plus retourner à la chambre où il m'avait conduit.
Arrêté.

Quelques jours après, je rencontrai ma
maîtresse qui me demanda : « Quand coucherons-nous ensemble? » — « Cette
nuit, lui dis-je, si tu le veux » — « Mais où? me dit-elle, est-ce dans
ton ancienne chambre ou dans la nouvelle? » — Instinctivement je
répondis, l'ancienne chambre voulant en passer l'inspection, et détruire
tout ce qui pouvait se rapporter au crime de Notre-Dame-de-Grâce. Cette
réponse causa mon malheur. C'est en me rendant dans cette chambre que je
fus arrêté, et même reconnu par un des agents civils, le nommé Nicolas
qui s'écria lorsque je fus arrêté : « Tiens, c'est Königstein. »
Le propriétaire de cette chambre l'avait fermée avec sa clef, moi j'y
avais fait poser une autre serrure, la seule dont je me servais, ne
m'occupant ni des clefs, ni de celle du propriétaire. Je rentrais par le
derrière de la maison sans être vu. Arrivé près de ma chambre,
impossible d'en ouvrir la porte, le bruit que je fis révéla ma présence,
et, comme je me disposais à m'en retourner, je vis la porte du
propriétaire s'ouvrir, et un homme en sortir. Sur le moment, je pris cet
homme pour le propriétaire qui venait se rendre compte du bruit qu'il
avait entendu, et, pensant en moi-même qu'il pouvait supposer la
présence d'un cambrioleur, je ne voulus pas fuir. Au contraire, je
m'arrêtai pour lui causer et me faire connaître. Aussitôt cet homme
sauta sur moi, et les autres qui étaient cachés chez le propriétaire
vinrent aussi me saisir. Ils eurent la chance que pour la première fois
depuis l'affaire de l'ermite, je n'eus pas d'arme sur moi, car j'en
aurais peut-être blessé quelques-uns, et j'aurais pu m'enfuir.
Ils m'attirèrent dans le logement du propriétaire. Là je me suis débattu
aussi violemment que possible, et je faisais même semblant d'appeler à
moi des camarades afin de les terroriser et de profiter de leur émoi
pour m'échapper. Ils m'ont ensuite fouillé et ont trouvé sur moi une
petite boîte en corne, boîte à bonbons provenant de l'ermitage. Elle
était difficile à ouvrir. Le commissaire qui la tenait, essayant de
l'ouvrir, je lui dis alors : « Prenez garde, elle va sauter. » Sur ce,
un agent m'interpella en ces termes : « Nom de Dieu, il a encore
l'audace de se f... de nous » (sic). Là, ils me mirent les
menottes et on est monté dans ma chambre où ils ont constaté que la
pendule, cinq édredons et une quantité d'objets venaient des vols de la
Côte. Ils essayèrent de me faire avouer et de leur donner des
explications, mais je leur répondis que je ne parlerais qu'à
l'instruction.
Évadé.
Nous partîmes alors, et causâmes en route. Arrivés à trois cents mètres
à peu près de la maison, près d'un chemin qui faisait une courbe, nous
rencontrâmes un homme porteur, je crois, d'un paquet. Les agents
l'interpellèrent. L'occasion de fuir me paraissant bonne, je fis
semblant de connaître cet homme, en l'appelant par des « psitt ». Les
paroles incohérentes que je lâchais, firent supposer aux agents que cet
individu était mon complice et m'abandonnèrent pour se ruer sur lui.
Aussitôt je pris la fuite en rebroussant chemin. Ils s'en aperçurent de
suite, mais j'avais gagné du terrain, et malgré leur poursuite ils ne
purent m'atteindre. Ils essayèrent toutefois de m'intimider en me tirant
un coup de revolver, mais ils ne m'atteignirent pas, et je pus continuer
ma route. Ceci se passait vers une heure du matin.
Déclaration pour être prononcé
lors de son procès,
le 21 juin 1892.
Si je prends la parole, ce n’est pas
pour me défendre des actes dont on m’accuse, car seule la société, qui
par son organisation met les hommes en lutte continuelle les uns contre
les autres, est responsable. En effet, ne voit-on pas aujourd’hui dans
toutes les classes et dans toutes les fonctions des personnes qui
désirent, je ne dirai pas la mort, parce que cela sonne mal à l’oreille,
mais le malheur de leurs semblables, si cela peut leur procurer des
avantages. Exemple : un patron ne fait-il pas des vœux pour voir un
concurrent disparaître ; tous les commerçants en général ne
voudraient-ils pas, et cela réciproquement, être seuls à jouir des
avantages que peut rapporter ce genre d’occupations ? L’ouvrier sans
emploi ne souhaite-t-il pas, pour obtenir du travail, que pour un motif
quelconque celui qui est occupé soit rejeté de l’atelier ? Eh bien, dans
une société où de pareils faits se produisent on n’a pas à être surpris
des actes dans le genre de ceux qu’on me reproche, qui ne sont que la
conséquence logique de la lutte pour l’existence que se font les hommes
qui, pour vivre, sont obligés d’employer toute espèce de moyen. Et,
puisque chacun est pour soi, celui qui est dans la nécessité n’en est-il
pas réduit a penser :
Eh bien, puisqu’il en est ainsi, je n’ai pas à hésiter, lorsque j’ai
faim, à employer les moyens qui sont à ma disposition, au risque de
faire des victimes ! Les patrons, lorsqu’ils renvoient des ouvriers,
s’inquiètent-ils s’ils vont mourir de faim ? Tous ceux qui ont du
superflu s’occupent-ils s’il y a des gens qui manquent des choses
nécessaires ?
Il y en a bien quelques-uns qui donnent des secours, mais ils sont
impuissants à soulager tous ceux qui sont dans la nécessité et qui
mourront prématurément par suite des privations de toutes sortes, ou
volontairement par les suicides de tous genres pour mettre fin à une
existence misérable et ne pas avoir à supporter les rigueurs de la faim,
les hontes et les humiliations sans nombre, et sans espoir de les voir
finir. Ainsi ils ont la famille Hayem et le femme Souhain qui a donné la
mort à ses enfants pour ne pas les voir plus longtemps souffrir, et
toutes les femmes qui, dans la crainte de ne pas pouvoir nourrir un
enfant, n’hésitent pas à compromettre leur santé et leur vie en
détruisant dans leur sein le fruit de leurs amours. Et toutes ces choses
se passent au milieu de l’abondance de toutes espèces de produits ! On
comprendrait que cela ait lieu dans un pays où les produits sont rares,
où il y a la famine.
Mais en France, où règne l’abondance, où les boucheries sont bondées de
viande, les boulangeries de pain, où les vêtements, la chaussure sont
entassés dans les magasins, où il y a des logements inoccupés !
Comment admettre que tout est bien dans la société, quand le contraire
se voit d’une façon aussi claire ?
Il y a bien des gens qui plaindront toutes ces victimes, mais qui vous
diront qu’ils n’y peuvent rien.
Que chacun se débrouille comme il peut !
Que peut-il faire celui qui manque du nécessaire en travaillant, s’il
vient a chômer ? Il n’a qu’à se laisser mourir de faim. Alors on jettera
quelques paroles de pitié sur son cadavre. C’est ce que j’ai voulu
laisser à d’autres. J’ai préféré me faire contrebandier, faux monnayeur,
voleur, meurtrier et assassin. J’aurais pu mendier : c’est dégradant et
lâche et c’est même puni par vos lois qui font un délit de la misère. Si
tous les nécessiteux, au lieu d’attendre, prenaient où il y a et par
n’importe quel moyen, les satisfaits comprendraient peut-être plus vite
qu’il y a danger à vouloir consacrer l’état social actuel, où
l’inquiétude est permanente et la vie menacée à chaque instant.
On finira sans doute plus vite par comprendre que les anarchistes ont
raison lorsqu’ils disent que pour avoir la tranquillité morale et
physique, il faut détruire les causes qui engendrent les crimes et les
criminels : ce n’est pas en supprimant celui qui, plutôt que de mourir
d’une mort lente par suite des privations qu’il a eues et aurait à
supporter, sans espoir de les voir finir, préfère, s’il a un peu
d’énergie, prendre violemment ce qui peut lui assurer le bien-être, même
au risque de sa mort qui ne peut être qu’un terme à ses souffrances.
Voilà pourquoi j’ai commis les actes que l’on me reproche et qui ne sont
que la conséquence logique de l’état barbare d’une société qui ne fait
qu’augmenter le nombre de ses victimes par la rigueur de ses lois qui
sévissent contre les effets sans jamais toucher aux causes ; on dit
qu’il faut être cruel pour donner la mort à son semblable, mais ceux qui
parlent ainsi ne voient pas qu’on ne s’y résout que pour l’éviter
soi-même.
De même, vous, messieurs les jurés, qui, sans doute, allez me condamner
à la peine de mort, parce que vous croirez que c’est une nécessité et
que ma disparition sera une satisfaction pour vous qui avez horreur de
voir couler le sang humain, mais qui, lorsque vous croirez qu’il sera
utile de le verser pour assurer la sécurité de votre existence,
n’hésiterez pas plus que moi à le faire, avec cette différence que vous
le ferez sans courir aucun danger, tandis que, au contraire, moi
j’agissais aux risque et péril de ma liberté et de ma vie.
Eh bien, messieurs, il n’y a plus de criminels à juger, mais les causes
du crime a détruire. En créant les articles du Code, les législateurs
ont oublié qu’ils n’attaquaient pas les causes mais simplement les
effets, et qu’alors ils ne détruisaient aucunement le crime ; en vérité,
les causes existant, toujours les effets en découleront. Toujours il y
aura des criminels, car aujourd’hui vous en détruisez un, demain il y en
aura dix qui naîtront. Que faut-il alors ? Détruire la misère, ce germe
de crime, en assurant à chacun la satisfaction de tous les besoins ! Et
combien cela est facile à réaliser ! Il suffirait d’établir la société
sur de nouvelles bases où tout serait en commun, et où chacun,
produisant selon ses aptitudes et ses forces, pourrait consommer selon
ses besoins.
Alors on ne verra plus des gens comme l’ermite de Notre-Dame-de-Grâce et
autres mendier un métal dont ils deviennent les esclaves et les
victimes ! On ne verra plus les femmes céder leurs appas, comme une
vulgaire marchandise, en échange de ce même métal qui nous empêche bien
souvent de reconnaître si l’affection est vraiment sincère. On ne verra
plus des hommes comme Pranzini, Prado, Berland, Anastay et autres qui,
toujours pour avoir de ce métal, en arrivent à donner la mort ! Cela
démontre clairement que la cause de tous les crimes est toujours la même
et qu’il faut vraiment être insensé pour ne pas la voir.
Oui, je le répète : c’est la société qui fait les criminels, et vous
jurés, au lieu de les frapper, vous devriez employer votre intelligence
et vos forces à transformer la société. Du coup, vous supprimeriez tous
les crimes ; et votre œuvre, en s’attaquant aux causes, serait plus
grande et plus féconde que n’est votre justice qui s’amoindrit à punir
les effets.
Je ne suis qu’un ouvrier sans instruction ; mais parce que j’ai vécu
l’existence des miséreux, je sens mieux qu’un riche bourgeois l’iniquité
de vos lois répressives. Où prenez-vous le droit de tuer ou d’enfermer
un homme qui, mis sur terre avec la nécessité de vivre, s’est vu dans la
nécessité de prendre ce dont il manquait pour se nourrir ? J’ai
travaillé pour vivre et faire vivre les miens ; tant que ni moi ni les
miens n’avons pas trop souffert, je suis resté ce que vous appelez
honnête. Puis le travail a manqué, et avec le chômage est venue la faim.
C’est alors que cette grande loi de la nature, cette voix impérieuse qui
n’admet pas de réplique, l’instinct de la conservation, me poussa à
commettre certains des crimes et délits que vous me reprochez et dont je
reconnais être l’auteur.
Jugez-moi, messieurs les jurés, mais si vous m’avez compris, en me
jugeant jugez tous les malheureux dont la misère, alliée à la fierté
naturelle, a fait des criminels, et dont la richesse, dont l’aisance
même aurait fait des honnêtes gens ! Une société intelligente en aurait
fait des gens comme tout le monde !
Ravachol
La
Ravachole,
chanson publiée dans L'Almanach
du Père Peinard,
1894.
(Air de
La Carmagnole et du Ça ira)
I
Dans la
grand'ville de Paris, (bis)
Il y a des bourgeois bien nourris. (bis)
Il y a les miséreux
Qui ont le ventre creux
Ceux-là ont les dents longues,
Vive le son, vive le son,
Ceux-là ont les dents longues,
Vive le son D'l'explosion !
REFRAIN
Dansons
la Ravachole,
Vive le son, vive le son,
Dansons la Ravachole,
Vive le son
D'l'explosion!
Ah, ça ira, ça ira, ça ira,
Tous les bourgeois goût'ront d'la bombe,
Ah, ça ira, ça ira, ça ira,
Tous les bourgeois on les saut'ra ... On les saut'ra!
II
II
y a les magistrats vendus, (bis)
Il y a les financiers ventrus, (bis)
Il y a les argousins.
Mais pour tous ces coquins
Il y a d'la dynamite,
Vive le son, vive le son,
Il y a d'la dynamite,
Vive le son
D'l'explosion !
(AU
REFRAIN)
III
II y a
les sénateurs gâteux, (bis)
Il y a les députés véreux, (bis)
II y a les généraux,
Assassins et bourreaux,
Bouchers en uniforme,
Vive le son, vive le son,
Bouchers en uniforme,
Vive le son
D'l'explosion !
(AU
REFRAIN)
IV
Il
y a les hôtels des richards, (bis)
Tandis que les pauvres dèchards, (bis)
A demi-morts de froid
Et soufflant dans leurs doigts,
Refilent la comète,
Vive le son, vive le son,
Refilent la comète,
Vive le son
D'l'explosion !
(AU
REFRAIN)
V
Ah,
nom de dieu, faut en finir ! (bis)
Assez longtemps geindre et souffrir! (bis)
Pas de guerre à moitié!
Plus de lâche pitié!
Mort à la bourgeoisie,
Vive le son, vive le son,
Mort à la bourgeoisie,
Vive le son
D'l'explosion !
(AU
REFRAIN)



