
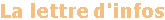 |
A voir et à lire
sur
19e.org,
et ailleurs.
 |
|
 | |


sur 19e.org |
|
|
|
|


Émile
Zola et l'Affaire.
Le procès Zola,
février-juillet 1898.
par Marc Nadaux
|
 |
Le 11 janvier 1898, l'acquittement du comandant
Esterhazy par le Conseil de guerre clôt l'Affaire sans que désormais
aucune chance d'une révision du procès d'Alfred Dreyfus subsiste. C'est
sans compter sans le courage de Zola, porté par une conviction
inébranlable et la soif de justice. J'Accuse place les intrigues de
couloir de l'État-major et du monde politique sur la place publique,
celle du procès Zola tout d'abord. Lors de l'audience du 17 février,
le général de Pellieux révèle l'existence du " faux Henry ",
que, le lendemain, les généraux Gonse et Boisdeffre viennent confirmer. C'est
une avancée qui se révélera décisive pour le parti dreyfusard. Mais
dans l'immédiat, l'écrivain est condamné à une année de prison,
assortie de 3.000 francs d'amende, soit le maximum encouru. Ceci le contraint
à l'exil et plonge ses partisans et les proches de l'ex capitaine Dreyfus
dans le désespoir.
 |
Zola au Palais de justice,
Le Petit Journal, 20 février 1898. |
 |
La déclaration
au jury, L'Aurore, 22 février 1898. |
 |
Le verdict, Le Figaro, 28 février
1898. |
 |
Départ de Zola,
Le Petit Journal,
31 juillet. |
Zola au Palais de justice,
Le Petit Journal, 20 février 1898.

La déclaration
au jury,
L'Aurore, 22 février 1898.
MESSIEURS LES JURÉS,
A la Chambre, dans la
séance du 22 janvier, M. Méline, président du conseil des
ministres, a déclaré, aux applaudissements frénétiques de sa
majorité complaisante, qu'il avait confiance dans les douze citoyens
aux mains desquels il remettait la défense de l'armée. C'était de
vous qu'il parlait, messieurs. Et, de même que M. le général Billot
avait dicté son arrêt au conseil de guerre, chargé d'acquitter le
commandant Esterhazy, en donnant du haut de la tribune à des
subordonnés la consigne militaire du respect indiscutable de la chose
jugée, de même M. Méline a voulu vous donner l'ordre de me
condamner au nom du respect de l'armée, qu'il m'accuse d'avoir
outragée. Je dénonce à la conscience des honnêtes gens cette
pression des pouvoirs publics sur la justice du pays. Ce sont là des
mœurs politiques abominables qui déshonorent une nation libre.
Nous verrons, messieurs, si vous obéirez. Mais il n'est pas vrai que
je sois ici, devant vous, par la volonté de M. Méline. Il n'a cédé
à la nécessité de me poursuivre que dans un grand trouble, dans la
terreur du nouveau pas que la vérité en marche allait faire. Cela
est connu de tout le monde. Si je suis devant vous, c'est que je l'ai
voulu. Moi seul ai décidé que l'obscure, la monstrueuse affaire
serait portée devant votre juridiction, et c'est moi seul, de mon
plein gré, qui vous ai choisis, vous l'émanation la plus haute, la
plus directe de la justice française, pour que la France sache tout
et se prononce. Mon acte n'a pas eu d'autre but, et ma personne n'est
rien, j'en ai fait le sacrifice, satisfait simplement d'avoir mis
entre vos mains, non seulement l'honneur de l'armée, mais l'honneur
en péril de toute la nation.
Vous me pardonneriez donc, si la lumière, dans vos consciences,
n'était pas encore entièrement faite. Cela ne serait pas de ma
faute. Il paraît que je faisais un rêve, en voulant vous apporter
toutes les preuves, en vous estimant les seuls dignes, les seuls
compétents. On a commencé par vous retirer de la main gauche ce
qu'on semblait vous donner de la droite. On affectait bien d'accepter
votre juridiction, mais si l'on avait confiance en vous pour venger
les membres d'un conseil de guerre, certains autres officiers
restaient intangibles, supérieurs à votre justice elle-même.
Comprenne qui pourra. C'est l'absurdité dans l'hypocrisie, et
l'évidence éclatante qui en ressort est qu'on a redouté votre bon
sens, qu'on n'a point osé courir le danger de nous laisser tout dire
et de vous laisser tout juger. Ils prétendent qu'ils ont voulu
limiter le scandale; et qu'en pensez vous, de ce scandale, de mon acte
qui consistait à vous saisir de l'affaire, à vouloir que ce fût le
peuple, incarné en vous, qui fût le juge ? Ils prétendent encore
qu'ils ne pouvaient accepter une révision déguisée, avouant ainsi
qu'ils n'ont qu'une épouvante au fond, celle de votre contrôle
souverain. La loi, elle a en vous sa représentation totale ; et c'est
cette loi du peuple élu que j'ai désirée, que je respecte
profondément, en bon citoyen, et non pas la louche procédure, grâce
à laquelle on a espéré vous bafouer vous-mêmes.
Me voilà excusé, messieurs, de vous avoir dérangés de vos
occupations, sans avoir eu le pouvoir de vous inonder de la totale
lumière que je rêvais. La lumière, toute la lumière, je n'ai eu
que ce passionné désir. Et ces débats viennent de vous le prouver,
nous avons eu à lutter, pas à pas, contre une volonté de ténèbres
extraordinaire d'obstination. Il a fallu un combat pour arracher
chaque lambeau de vérité, on a discuté sur tout, on nous a refusé
tout, on a terrorisé nos témoins, dans l'espoir de nous empêcher de
faire la preuve. Et c'est pour vous seuls que nous nous sommes battus,
c'est pour que cette preuve vous fût soumise entière, afin que vous
puissiez vous prononcer sans remords, dans votre conscience. Je suis
donc certain que vous nous tiendrez compte de nos efforts, et que,
d'ailleurs, assez de clarté a pu être faite. Vous avez entendu les
témoins, vous allez entendre mon défenseur', qui vous dira
l'histoire vraie, cette histoire qui affole tout le monde, et que
personne ne connaît. Et me voilà tranquille, la vérité est en vous
maintenant: elle agira.
M. Méline a donc cru dicter votre arrêt, en vous confiant l'honneur
de l'armée. Et c'est au nom de cet honneur de l'armée que je fais
moi-même appel à votre justice. Je donne à M. Méline le plus
formel démenti, je n'ai jamais outragé l'armée. J'ai dit, au
contraire, ma tendresse, mon respect pour la nation en armes, pour nos
chers soldats de France qui se lèveraient à la première menace, qui
défendraient la terre française. Et il est également faux que j'aie
attaqué les chefs, les généraux qui les mèneraient à la victoire.
Si quelques individualités des bureaux de la guerre ont compromis
l'armée elle-même par leurs agissements, est-ce donc insulter
l'armée tout entière que de le dire ? N'est-ce pas plutôt faire
œuvre de bon citoyen que de la dégager de toute compromission, que
de jeter le cri d'alarme, pour que les fautes, qui, seules, nous ont
fait battre, ne se reproduisent pas et ne nous mènent pas à de
nouvelles défaites ? Je ne me défends pas d'ailleurs, je laisse à
l'histoire le soin de juger mon acte, qui était nécessaire. Mais
j'affirme qu'on déshonore l'armée, quand on laisse les gendarmes
embrasser le commandant Esterhazy, après les abominables lettres
qu'il a écrites. J'affirme que cette vaillante armée est insultée
chaque jour par les bandits qui, sous prétexte de la défendre, la
salissent de leur basse complicité, en traînant dans la boue tout ce
que la France compte encore de bon et de grand. J'affirme que ce sont
eux qui la déshonorent, cette grande armée nationale, lorsqu'ils
mêlent les cris de: Vive l'armée! à ceux de : A mort les juifs! Et
ils ont crié: Vive Esterhazy! Grand Dieu! le peuple de Saint Louis,
de Bayard, de Condé et de Hoche, le peuple qui compte cent victoires
géantes, le peuple des grandes guerres de la République et de
l'Empire, le peuple dont la force, la grâce et la générosité ont
ébloui l'univers, criant: Vive Esterhazy ! C'est une honte dont notre
effort de vérité et de justice peut seul nous laver.
Vous connaissez la légende qui s'est faite. Dreyfus a été condamné
justement et légalement par sept officiers infaillibles, qu'on ne
peut même suspecter d'erreur sans outrager l'armée entière. Il
expie dans une torture vengeresse son abominable forfait. Et, comme il
est juif, voilà qu'un syndicat juif s'est créé, un syndicat
international de sans-patrie, disposant de millions par centaines,
dans le but de sauver le traître, au prix des plus impudentes manœuvres.
Dès lors, ce syndicat s'est mis à entasser les crimes, achetant les
consciences, jetant la France dans une agitation meurtrière, décidé
à la vendre à l'ennemi, à embraser l'Europe d'une guerre
générale, plutôt que de renoncer à son effroyable dessein. Voilà,
c'est très simple, même enfantin et imbécile, comme vous le voyez.
Mais c'est de ce pain empoisonné que la presse immonde nourrit notre
pauvre peuple depuis des mois. Et il ne faut pas s'étonner, si nous
assistons à une crise désastreuse, car lorsqu'on sème à ce point
la sottise et le mensonge, on récolte forcément la démence.
Certes, messieurs, je ne vous fais pas l'injure de croire que vous
vous en étiez tenus, jusqu'ici, à ce conte de nourrice. Je vous
connais, je sais qui vous êtes. Vous êtes le cœur et la raison de
Paris, de mon grand Paris, où je suis né, que j'aime d'une infinie
tendresse, que j'étudie et que je chante depuis bientôt quarante
ans. Et je sais également, à cette heure, ce qui se passe dans vos
cerveaux; car, avant de venir m'asseoir ici, comme accusé, j'ai
siégé là, au banc où vous êtes. Vous y représentez l'opinion
moyenne, vous tâchez d'être, en masse, la sagesse et la justice.
Tout à l'heure, je serai en pensée avec vous dans la salle de vos
délibérations, et je suis convaincu que votre effort sera de
sauvegarder vos intérêts de citoyens, qui sont naturellement, selon
vous, les intérêts de la nation entière. Vous pourrez vous tromper,
mais vous vous tromperez dans la pensée, en assurant votre bien,
d'assurer le bien de tous.
Je vous vois dans vos familles, le soir, sous la lampe; je vous
entends causer avec vos amis, je vous accompagne dans vos ateliers,
dans vos magasins. Vous êtes tous des travailleurs, les uns
commerçants, les autres industriels, quelques-uns exerçant des
professions libérales. Et votre très légitime inquiétude est
l'état déplorable dans lequel sont tombées les affaires. Partout,
la crise actuelle menace de devenir un désastre, les recettes
baissent, les transactions deviennent de plus en plus difficiles. De
sorte que la pensée que vous avez apportée ici, la pensée que je
lis sur vos visages, est qu'en voilà assez et qu'il faut en finir.
Vous n'en êtes pas à dire comme beaucoup: " Que nous importe
qu'un innocent soit à l'île du Diable ! est-ce que l'intérêt d'un
seul vaut la peine de troubler ainsi un grand pays ? " Mais vous
vous dites tout de même que notre agitation, à nous les affamés de
vérité et de justice, est payée trop chèrement par tout le mal
qu'on nous accuse de faire. Et, si vous me condamnez, messieurs, il
n'y aura que cela au fond de votre verdict: le désir de calmer les
vôtres, le besoin que les affaires reprennent, la croyance qu'en me
frappant, vous arrêterez une campagne de revendication nuisible aux
intérêts de la France.
Eh bien! messieurs, vous vous tromperiez absolument. Veuillez me faire
l'honneur de croire que je ne défends pas ici ma liberté. En me
frappant, vous ne feriez que me grandir. Qui souffre pour la vérité
et la justice devient auguste et sacré. Regardez-moi, messieurs:
ai-je mine de vendu, de menteur et de traître ? Pourquoi donc
agirais-je ? Je n'ai derrière moi ni ambition politique, ni passion
de sectaire. Je suis un libre écrivain, qui a donné sa vie au
travail, qui rentrera demain dans le rang et reprendra sa besogne
interrompue. Et qu'ils sont donc bêtes ceux qui m'appellent
l'Italiens, moi né d'une mère française, élevé par de
grands-parents beaucerons, des paysans de cette forte terre, moi qui
ai perdu mon père à sept ans, qui ne suis allé en Italie qu'à
cinquante-quatre ans, et pour documenter un livre. Ce qui ne
m'empêche pas d'être très fier que mon père soit de Venise, la
cité resplendissante dont la gloire ancienne chante dans toutes les
mémoires. Et, si même je n'étais pas français, est-ce que les
quarante volumes de langue française que j'ai jetés par millions
d'exemplaires dans le monde entier, ne suffiraient pas à faire de moi
un Français, utile à la gloire de la France !
Donc, je ne me défends pas. Mais quelle erreur serait la vôtre, si
vous étiez convaincus qu'en me frappant, vous rétabliriez l'ordre
dans notre malheureux pays ! Ne comprenez-vous pas, maintenant, que ce
dont la nation meurt, c'est de l'obscurité où l'on s'entête à la
laisser, c'est de l'équivoque où elle agonise ? Les fautes des
gouvernants s'entassent sur les fautes, un mensonge en nécessite un
autre, de sorte que l'amas devient effroyable. Une erreur judiciaire a
été commise, et dès lors, pour la cacher, il a fallu chaque jour
commettre un nouvel attentat au bon sens et à l'équité. C'est la
condamnation d'un innocent qui a entraîné l'acquittement d'un
coupable; et voilà, aujourd'hui, qu'on vous demande de me condamner
à mon tour, parce que j'ai crié mon angoisse, en voyant la patrie
dans cette voie affreuse. Condamnez-moi donc! mais ce sera une faute
encore, ajoutée aux autres, une faute dont plus tard vous porterez le
poids dans l'histoire. Et ma condamnation, au lieu de ramener la paix
que vous désirez, que nous désirons tous, ne sera qu'une semence
nouvelle de passion et de désordre. La mesure est comble, je vous le
dis, ne la faites pas déborder.
Comment ne vous rendez-vous pas un compte exact de la terrible crise
que le pays traverse ? On dit que nous sommes les auteurs du scandale,
que ce sont les amants de la vérité et de la justice qui détraquent
la nation, qui poussent à l'émeute. En vérité, c'est se moquer du
monde. Est-ce que le général Billot, pour ne nommer que lui, n'est
pas averti depuis dix-huit mois ? Est-ce que le colonel Picquart n'a
pas insisté pour qu'il prît la révision en main, s'il ne voulait
pas laisser l'orage éclater et tout bouleverser ? Est-ce que M.
Scheurer-Kestner ne l'a pas supplié, les larmes aux yeux, de songer
à la France, de lui éviter une pareille catastrophe ? Non, non !
notre désir a été de tout faciliter, de tout amortir, et si le pays
est dans la peine, la faute en est au pouvoir qui, désireux de
couvrir les coupables, et poussé par des intérêts politiques, a
tout refusé, espérant qu'il serait assez fort pour empêcher la
lumière d'être faite. Depuis ce jour, il n'a manœuvré que dans
l'ombre, pour les ténèbres, et c'est lui, lui seul, qui est
responsable du trouble éperdu où sont les consciences.
L'affaire Dreyfus, ah! messieurs, elle est devenue bien petite à
l'heure actuelle, elle est bien perdue et bien lointaine, devant les
terrifiantes questions qu'elle a soulevées. Il n'y a plus d'affaire
Dreyfus, il s'agit désormais de savoir si la France est encore la
France des droits de l'homme, celle qui a donné la liberté au monde
et qui devait lui donner la justice. Sommes-nous encore le peuple le
plus noble, le plus fraternel, le plus généreux ? Allons-nous garder
en Europe notre renom d'équité et d'humanité ? Puis, ne sont-ce pas
toutes les conquêtes que nous avions faites et qui sont remises en
question ? Ouvrez les yeux et comprenez que, pour être dans un tel
désarroi, l'âme française doit être remuée jusque dans ses
intimes profondeurs, en face d'un péril redoutable. Un peuple n'est
point bouleversé de la sorte, sans que sa vie morale elle-même soit
en danger. L'heure est d'une gravité exceptionnelle, il s'agit du
salut de la nation.
Et, quand vous aurez compris cela, messieurs, vous sentirez qu'il
n'est qu'un seul remède possible: dire la vérité, rendre la
justice. Tout ce qui retardera la lumière, tout ce qui ajoutera des
ténèbres aux ténèbres, ne fera que prolonger et aggraver la crise.
Le rôle des bons citoyens, de ceux qui sentent l'impérieux besoin
d'en finir, est d'exiger le grand jour. Nous sommes déjà beaucoup à
le penser. Les hommes de littérature, de philosophie et de science,
se lèvent de toute part, au nom de l'intelligence et de la raison. Et
je ne vous parle pas de l'étranger, du frisson qui a gagné l'Europe
tout entière. Pourtant l'étranger n'est pas forcément l'ennemi. Ne
parlons pas des peuples qui peuvent être demain des adversaires. Mais
la grande Russie, notre alliée, mais la petite et généreuse
Hollande, mais tous les peuples sympathiques du Nord, mais ces terres
de langue française, la Suisse et la Belgique, pourquoi donc
ont-elles le cœur si gros, si débordant de fraternelle souffrance ?
Rêvez-vous donc une France isolée dans le monde ? Voulez-vous, quand
vous passerez la frontière, qu'on ne sourie plus à votre bon renom
légendaire d'équité et d'humanité ?
Hélas ! messieurs, ainsi que tant d'autres, vous attendez peut-être
le coup de foudre, la preuve de l'innocence de Dreyfus, qui
descendrait du ciel comme un tonnerre. La vérité ne procède point
ainsi d'habitude, elle demande quelque recherche et quelque
intelligence. La preuve! nous savons bien où l'on pourrait la
trouver. Mais nous ne songeons à cela que dans le secret de nos
âmes, et notre angoisse patriotique est qu'on se soit exposé à
recevoir un jour le soufflet de cette preuve, après avoir engagé
l'honneur de l'armée dans un mensonge. Je veux aussi déclarer
nettement que, si nous avons notifié comme témoins certains membres
des ambassades, notre volonté formelle était à l'avance de ne pas
les citer ici. On a souri de notre audace. Je ne crois pas qu'on en
ait souri au ministère des affaires étrangères, car là on a dû
comprendre. Nous avons simplement voulu dire à ceux qui savent toute
la vérité, que nous la savons, nous aussi. Cette vérité court les
ambassades, elle sera demain connue de tous. Et il nous est impossible
d'aller dès maintenant la chercher où elle est, protégée par
d'infranchissables formalités. Le gouvernement qui n'ignore rien, le
gouvernement qui est convaincu, comme nous, de l'innocence de Dreyfus,
pourra, quand il le voudra, et sans risque, trouver les témoins qui
feront enfin la lumière.
Dreyfus est innocent, je le jure. J'y engage ma vie, j'y engage mon
honneur. A cette heure solennelle, devant ce tribunal qui représente
la justice humaine, devant vous, messieurs les jurés, qui êtes
l'émanation même de la nation, devant toute la France, devant le
monde entier, je jure que Dreyfus est innocent. Et, par mes quarante
années de travail, par l'autorité que ce labeur a pu me donner, je
jure que Dreyfus est innocent. Et, par tout ce que j'ai conquis, par
le nom que je me suis fait, par mes œuvres qui ont aidé à
l'expansion des lettres françaises, je jure que Dreyfus est innocent.
Que tout cela croule, que mes œuvres périssent, si Dreyfus n'est pas
innocent! Il est innocent.
Tout semble être contre moi, les deux Chambres, le pouvoir civil, le
pouvoir militaire, les journaux à grand tirage, l'opinion publique
qu'ils ont empoisonnée. Et je n'ai pour moi que l'idée d'un idéal
de vérité et de justice. Et je suis bien tranquille, je vaincrai.
Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et dans
l'injustice. On peut me frapper ici. Un jour, la France me remerciera
d'avoir aidé à sauver son honneur.
Le verdict,
Le Figaro, 28 février
1898.
Il est six heures et demi au moment
où Me Labori achève sa réplique.
M. le Président demande à M. Émile Zola et à M. Perreux, gérant de L’Aurore,
s’ils ont quelques chose à ajouter pour leur défense.
Les deux prévenus répondent négativement.
M. le Président Delegorgue prononce alors la phrase sacramentelle :
" les débats sont terminés ", et donne lecture au jury des
questions qui lui sont posées.
Ces questions sont au nombre de deux :
1. Perreux est-il coupable d’avoir commis une diffamation
publique envers les membres du Ier Conseil de guerre de Paris, en imprimant qu’il
avait acquitté par ordre un coupable ?
2 . Émile Zola s’est-il rendu coupable du délit de diffamation
ci-dessus spécifié, en fournissant à Perreux, les moyens de les
commettre ?
Les jurés se retirent pour délibérer.
A sept heures dix, ils rentrent en séance, et le chef du jury, la main sur son
cœur, donne lecture du verdict :
- sur mon honneur et sur ma conscience, devant Dieu et devant les Hommes, la
réponse du jury est
" en ce qui concerne M. Perreux : oui, à la majorité ;
" en ce qui concerne M. Émile Zola : oui, à la
majorité ".
Le verdict est muet sur les circonstances atténuantes. !
Aussitôt, des applaudissements frénétiques éclatent de toutes les parties de
la salle. On crie : " Vive le jury ! A bas Zola ! Mort
aux Juifs !Vive l’armée ! Vive les généraux ! ".
Des spectateurs sont montés sur les bancs, sur les tables ; d’autres
agitent frénétiquement des chapeaux hissés au bout de leurs cannes.
– Cannibales ! s’écrie M. Émile Zola.
Quant le calme s’est un peu rétablie, M. le Président donne la parole à M.
l’avocat général Van Cassel, qui requiert l’application aux deux
condamnés de la loi de 1881 sur la presse.
– M. Perreux, demande M. le Président Delegorgue, qu’avez-vous à dire sur
l’application de la peine ?
– Rien.
– Et vous, Monsieur Émile Zola, avez-vous quelques observations à
faire ?.
–Aucune.
Messieurs Labori et Albert Clemenceau, également interpellés, se bornent à
lever leur toques sans répondre.
M. le Président. – La cour se retire pour en délibérer.
Cinq minutes plus tard, la cour rentre en séance, et M. le Président
Delegorgue donne lecture de l’arrêt qui condamne :
M. Perreux, gérant de L’Aurore, à quatre mois de prison et 3.000
francs d’amende ;
M. Émile Zola à UN AN DE PRISON, maximum de la peine et 3.000 francs d’amende.
Aussitôt, de nouveaux applaudissements
retentissent : " Vive le jury ! A bas Zola ! Mort
aux Juifs !Vive l’armée ! Vive les généraux ! ",
quelques amis, M. Fasquelle, M. Desmoulins, Me Labori embrassent M. Émile Zola.
D’autres s’empressent autour de lui pour lui serrer la main.
La salle est évacuée au milieu d’un tapage épouvantable, auquel répondent
sourdement de longues clameurs qui montent du dehors. C’est d’une impression
saisissante, à la fois terrifiante et grandiose.
On n’entend même pas M. le Président Delegorgue annoncer aux condamnés qu’ils
ont trois jours pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt qui vient de les
frapper
L’audience est levée à sept heures et demi.
Zola au Palais de justice,
Le Petit Journal, 20 février 1898.

|



