
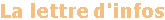 |
A voir et à lire
sur
19e.org,
et ailleurs.
 |
|
 | |


sur 19e.org |
|
|
|
|


La
crise du 16 mai 1877.
Message et décret du Maréchal de
Mac-Mahon,
président de la République,
lus à la Chambre des députés,
16 mai 1877.
par Marc Nadaux
|
 |
Le
président Mac-Mahon en effet appelle Armand Dufaure, l'ancien ministre de
Louis-Philippe, à former un nouveau cabinet. Cependant, dès le mois de
décembre 1876, lui succède Jules Simon, dans ces fonctions de président
du Conseil, l'alternative qui s'offre aux gouvernants demeurant
inchangée, à savoir gouverner au centre. La présidentialisation du
régime - autrement dit son interprétation monarchiste - , quelques
différends opposent les deux têtes du pouvoir exécutif.
Après
la démission du ministère Jules Simon, Mac Mahon confie de nouveau la Présidence
du Conseil et le ministère de la Justice, à Albert de Broglie, le 17 mai
1877. Celui-ci fait dissoudre la Chambre, le 25 juin suivant, et s'efforce
sans succès d'assurer l'élection d'une majorité conservatrice. |
Message et décret du Maréchal de Mac-Mahon,
président de la République,
lus à la Chambre des députés,
16 mai 1877.
Messieurs les députés,
j'ai dû me séparer du ministère que
présidait M. Jules Simon et en former un nouveau. Je
dois vous faire l'exposé sincère des motifs qui
m'ont amené à prendre cette décision.
Vous savez tous avec quel scrupule, depuis le 25
février 1875, jour où l'Assemblée
nationale a donné à la France une constitution
républicaine, j'ai observé, dans l'exercice du
pouvoir qui m'est confié, toutes les prescriptions
de cette loi fondamentale.
Après les élections de l'année dernière, j'ai voulu
choisir pour ministres des hommes que je supposais
être en accord de sentiments avec la majorité de la
Chambre des députés.
J'ai formé, dans cette pensée, successivement, deux
ministères.
Le premier avait à sa tête M. Dufaure,
vétéran de nos assemblées politiques, l'un des
auteurs de la Constitution, aussi estimé pour la
loyauté de son caractère qu'illustre par son
éloquence.
M. Jules Simon qui a présidé le second, attaché de
tous temps à la forme républicaine, voulait, comme
M. Dufaure, la concilier avec tous les principes
conservateurs.
Malgré le concours loyal que je leur ai prêté, ni
l'un ni l'autre de ces ministères n'a pu réunir,
dans la Chambre des députés, une majorité solide
acquise à ses propres idées.
M. Dufaure a vainement essayé, l'année dernière,
dans la discussion du budget, de prévenir des
innovations qu'il regardait justement comme très
fâcheuses.
Le même échec était réservé au président du dernier
cabinet, sur des points de législation très graves
au sujet desquels il était tombé d'accord avec
moi, qu'aucune modification ne devait être admise.
Après ces deux tentatives, également dénuées de
succès, je ne pourrais faire un pas de plus dans la
même voie sans faire appel ou demander appui à une
autre fraction du Parti républicain, celle qui croit
que la République ne peut s'affermir sans avoir pour
complément et pour conséquence la modification
radicale de toutes nos grandes institutions
administratives, judiciaires, financières et
militaires. Ce programme est bien connu. Ceux qui le
professent sont d'accord sur tout ce qu'il contient.
Ils ne diffèrent entre eux que sur les moyens à
employer et le temps opportun pour l'appliquer.
Ni ma conscience, ni mon patrimoine, ne me
permettent de m'associer, même de loin et pour
l'avenir, au triomphe de ces idées. Je ne les crois
opportunes ni pour aujourd'hui, ni pour demain. A
quelque époque qu'elles dussent prévaloir, elles
n'engendreraient que le désordre et l'abaissement de
la France.
Je ne veux ni en tenter l'application moi-même, ni
en faciliter l'essai à mes successeurs.
Tant que je serai dépositaire du pouvoir, j'en ferai
usage dans toute l'étendue de ses limites légales,
pour m'opposer à ce que je regarde comme la perte de
mon pays. Mais je suis convaincu que ce pays pense
comme moi.
Ce n'est pas le triomphe de ces théories qu'il a
voulu aux élections dernières. Ce n'est pas ce que
lui ont annoncé ceux - c'étaient presque tous les
candidats - qui se prévalaient de mon nom et se
déclaraient résolus à soutenir mon pouvoir. S'il
était interrogé de nouveau, et de manière à prévenir
tout malentendu, il repousserait, j'en suis sûr,
cette confusion.
J'ai donc dû choisir, et c'était mon droit
constitutionnel, des conseillers qui pensent comme
moi, sur ce point, qui est, en réalité, le seul en
question. Je n'en reste pas moins, aujourd'hui comme
hier, fermement résolu à respecter et à maintenir
les institutions qui sont l'œuvre de l'Assemblée de
qui je tiens le pouvoir, et qui ont constitué la
République. Jusqu'en 1880, je suis le seul
qui pourrait proposer d'y introduire un changement
et je ne médite rien de ce genre.
Tous mes conseillers sont, comme moi, décidés à
pratiquer loyalement les institutions, et incapables
d'y porter aucune atteinte.
Je livre ces considérations à vos réflexions comme
au jugement du pays.
Pour laisser calmer l'émotion qu'ont causée les
derniers incidents, je vous inviterai à suspendre
vos séances pendant un certain temps.
Quand vous les reprendrez, vous pourrez vous mettre,
toute autre affaire cessante, à la discussion du
budget, qu'il est si important de mener bientôt à
terme.
D'ici là, mon gouvernement veillera à la paix
publique. Au-dedans, il ne souffrirait rien qui la
compromette. Au-dehors, elle sera maintenue, j'en ai
la confiance, malgré les agitations qui troublent
une partie de l'Europe, grâce aux bons rapports que
nous entretenons et voulons conserver avec toutes
les puissances, et à cette politique de neutralité
et d'abstention qui vous a été exposée tout
récemment, et que vous avez confirmée par votre
approbation unanime. Sur ce point, aucune différence
d'opinion ne s'élève entre les partis. Ils veulent
tous le même but, par le même moyen. Le nouveau
ministère pense exactement comme l'ancien, et pour
bien attester cette conformité de sentiment, la
direction politique étrangère est restée dans les
mêmes mains.
Si quelques imprudences de parole ou de presse
compromettaient cet accord, que nous voulons tous,
j'emploierai pour les réprimer les moyens que la loi
met en mon pouvoir, et pour les prévenir je fais
appel au patriotisme qui, Dieu merci ! ne fait
défaut en France à aucune classe de citoyens.
Mes ministres vont vous donner lecture du décret
qui, conformément à l'article 2 de la loi
constitutionnelle du 16 juillet 1875, ajourne
les Chambres pour un mois.
DÉCRET
Le
président de la République française, Vu l'article 2
de la loi du 16 juillet
1875,
Décrète :
Art. 1er. - Le Sénat et la Chambre des
députés sont ajournés au 16 juin 1877.
Art. 2. - Le présent décret sera porté au Sénat par
le garde des Sceaux, président du Conseil, et à la
Chambre des députés par le ministre de l'Intérieur.
Message du président de la
République suivi d'un décret portant prorogation du
Sénat et de la Chambre des députés, lu à la Chambre
des députés par M. de Fourtou, ministre de
l'Intérieur, J.O., 19 mai 1877.
|



