
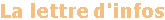 |
A voir et à lire
sur
19e.org,
et ailleurs.
 |
|
 | |


sur 19e.org |
|
|
|
|


|
Louis-Napoléon
Bonaparte,
un opposant au régime.
Le
procès devant la Chambre des Pairs,
26 septembre - octobre 1840.
par Marc Nadaux
|
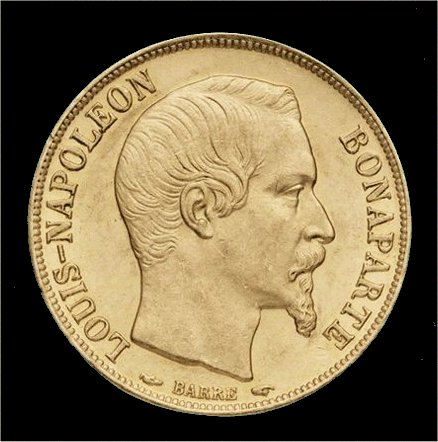 |
Arrêté et fait prisonnier, le prétendant bonapartiste
comparait à partir du 26 septembre au 6 octobre devant la
Chambre des Pairs. Le grand avocat, qui est en même temps devenu au cours
des années passées le chef de file du parti légitimiste, Pierre Antoine
Berryer, assure sa défense. Malgré l'éloquence de ce dernier, Louis-Napoléon
Bonaparte est condamné à la prison perpétuelle.
Voici le récit du procès, rédigé par le comte de Falloux, à l'époque
un jeune aristocrate angevin récemment monté à Paris. Ce texte, qui est
un extrait des Mémoires d'un Royaliste, a été publié en 1888. |
C'est alors que me surprit, en même temps que la France entière,
1a seconde expédition du prince Louis Bonaparte. Débarqué à Boulogne
avec une faible escorte, le 6 août 1840, vaincu sans combat, immédiatement
captif, le prince fut transféré au Luxembourg et déféré à la cour
des pairs. Son procès s'ouvrit vers la fin du mois de septembre au milieu
d'une indifférence glaciale. Je ne perdais jamais volontairement une
occasion d’entendre M. Berryer, et l'habileté, l'élévation de sa
parole ne pouvaient être mises à une épreuve plus délicate que dans
une cause, où le chef avoué du parti monarchique allait défendre
loyalement celui qui prétendait revendiquer des droits à l'empire. Je
courus à ce rez-de-chaussée, au fond d'une cour obscure et étroite de
la rue des Petits-Champs. Je n'ai jamais franchi ce seuil, sans un respect
ému, et je demandai à M. Berryer, en m'excusant de mon indiscrétion, si
je ne pourrais être compté parmi ses heureux auditeurs : « Rien n'est
plus facile, me répondit-il avec sa simplicité ordinaire ; vous êtes le
premier qui m'ayez demandé un billet, et je pourrai sans doute vous le
remettre demain, car je vais tous les jours au Luxembourg me concerter
avec mon client, chez qui j'ai bien des chimères à vaincre avant
l'ouverture des débats. - Puisqu'il en est ainsi, repris-je,
pourriez-vous joindre une seconde bonté à la première ? J'ai, dans la
prison du Luxembourg, vous en serez surpris, un ami auquel personne ne
songe et que personne ne connaît. Il se nomme le vicomte Fialin de
Persigny. Les immunités du défenseur ne vous permettent elles pas de lui
apprendre que je me trouve à Paris et qu'il m'en coûterait beaucoup de
l'entrevoir seulement du haut des tribunes publiques ? » Le lendemain, dès
qu'il me vit entrer dans son cabinet, M. Berryer s'écria : « Combien je
vous remercie de la commission que vous m'avez donnée ! Jamais je n'ai vu
joie et reconnaissance plus vives ! - Ma famille me réprouve, m'a dit M.
de Persigny, elle ne m'envoie que des reproches, et sans M. de Falloux, je
n'aurais pu serrer une main amie ! » M. Berryer me remit en même
temps une autorisation du chancelier pour pénétrer dans le parloir de la
prison.
C'était une assez petite salle, au milieu de laquelle s'élevaient
deux grilles en bois, et dans l'espace ménagé entre les deux grilles se
promenait un sergent de ville. J'entrai d'un côté, M. de Persigny entra
de l'autre, fondant en larmes ; il me tendit la main à travers l'espace
qui nous séparait, et, en lui rendant cordialement son étreinte, je
sentis qu'il me glissait dans la main un papier que je mis aussitôt dans
ma poche. Notre conversation fut aussi expansive qu'elle pouvait l'être
en présence du témoin qui passait et repassait entre nous, comme un
balancier de pendule. A peine sorti du Luxembourg, je lus rapidement le
billet de M. de Persigny. Il me donnait l'adresse de la maison où étaient
déposés ses uniformes, destinés à l’entrée dans Paris, me priait de
les vendre et m'indiquait l'emploi à faire de la petite somme qui en
proviendrait. Je m’acquittais de mon mieux de la commission et je suivis
assidûment le procès, plus convaincu, d'audience en audience, de
l'inanité des espérances napoléoniennes.
Le prince Louis avait une attitude digne et calme, un regard
terne, des gestes gauches et un accent étranger qui participait à la
fois de l'Allemand et de l'Anglais. Quand le grenadier Geoffroy qu'il
avait brièvement blessé à Boulogne d'un coup de pistolet fut introduit
comme témoin, un vif mouvement d'intérêt et de curiosité éclata dans
les tribunes ; tous les regards se portèrent à la fois sur le visage
mutilé du soldat et sur les traits impassibles du prince. Lorsque le
chancelier lui demanda d'un ton sévère s'il n'avait pas d'observation à
faire sur la déposition du témoin, le prince répondit : « Je n'ai rien
â dire, si ce n'est que je regrette vivement d'avoir, par hasard, blessé
un soldat français et que je suis heureux que cela n'ait pas eu de plus fâcheux
résultats ». Cette maladroite réponse et surtout le mot « par
hasard » produisirent une pénible impression sur la cour des Pairs et
sur le public.
Le procureur général, M. Franck Carré, accabla de son dédain
le prince Louis et ses compagnons ; aussi, quand M. Berryer se leva,
tout le monde était convaincu de son découragement et l'on n'attendait
que les mots résignés qui sortent de la bouche d'un avocat d'office. Je
crus volontiers, pour mon compte, que là se bornerait le rôle de
l'illustre défenseur, car, en traversant les couloirs du Luxembourg pour
gagner ma place, j'avais entendu un avocat en robe, M° Ledru, dire à un
autre avocat, qui gagnait avec lui le banc de la défense : « Je ne sais
pas ce qu'a Berryer ; il est d'une humeur massacrante. Sa Majesté
l'Empereur lui aura certainement fait une crasse ». J'avais examiné avec
d'autant plus d'attention la physionomie de M. Berryer ; elle n'avait pas
ce caractère soucieux, presque sombre que lui imprimait d'ordinaire,
avant un grand débat, cette crise de la parole, ainsi qu'il la nommait
lui-même. Il paraissait nerveux, irrité et passait brusquement,
machinalement ses mains sur son visage. En effet, il me l'a dit depuis,
avant d'entrer à l’audience ; le prince lui avait montré le petit
discours qu'il se proposait de prononcer, discours qui compliquait étrangement
les difficultés de la défense, car il différait essentiellement de
celui qui était convenu depuis plusieurs jours. C'est dans ces conditions
que le défenseur se leva devant un auditoire mécontent et moqueur pour répondre
à un réquisitoire injurieux, au nom d'un client dont l'attitude abattue
laissait deviner qu'il s'apercevait, mais trop tard, du mauvais effet de
ses provocations.
Dès les premiers mots de M. Berryer, la scène changea : on
comprit qu'il avait retrempé son courage, qu'il avait rassemblé toutes
ses forces et qu'il allait plaider à fond non pour ses auditeurs
seulement, mais pour le pays tout entier. II ne laissa échapper aucune témérité
de langage, pas un mot blessant, pas un oubli de ce respect dû à la loi,
dû aussi à l'assemblée qu'il tint constamment frémissante, et
invinciblement charmée. Les applaudissements furent sur le point d'éclater
dans les tribunes, les murmures sur les bancs de la pairie, mais tout fait
contenu, tout fut dominé par l'irrésistible enchaînement des idées et
l'irréprochable convenance de langage. Tout était transparent, tout fut
compris, rien ne fut interrompu, rien ne fut arrêté et plus d’un front
se baissa sous le coup de cette écrasante apostrophe : « Il y
a un arbitre inévitable, éternel, entre tout juge et tout accusé ;
avant de juger, devant cet arbitre et à la face du pays qui entendra vos
arrêts, dites-vous, sans avoir égard à la faiblesse des moyens; le
droit, les lois, la constitution devant les yeux, la main sur la
conscience; devant Dieu, devant le pays, devant nous qui vous connaissons,
dites : - S'il eut réussi, s'il eût triomphé, ce droit, je l'aurais nié,
j'aurais refusé toute participation à ce pouvoir, je l'aurais méconnu,
je l'aurais repoussé. - Moi, j'accepte cet arbitrage suprême, et
quiconque devant Dieu, devant le pays, me dira : - S'il eût réussi, je
l'aurais nié ce droit ! - celui-là, je l'accepte pour juge.
Le prince Napoléon fut cependant condamné à une détention
perpétuelle qu’il abrégea bientôt en s'évadant du fort de Ham. M. de
Persigny fut détenu à Doullens, puis transféré à Versailles.
|



